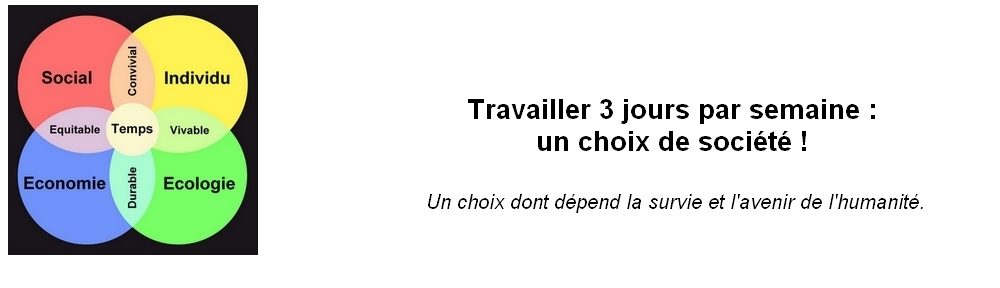Au 20e siècle, la Religion de la consommation est devenue le pilier central de la Religion économique. La société de consommation a émergé aux États-Unis au début des années 20[1], avant de s’étendre aux pays d’Europe de l’Ouest au début des années 50. Après la Première Guerre mondiale, les gains de productivité générés par le progrès technique ont permis aux entreprises américaines d’augmenter leur capacité de production. Au lieu de se transformer en source de profit supplémentaire, ces gains ont provoqué une surproduction et des surcoûts de stocks à l’origine de surcoûts financiers et de faillite d’entreprises. Pour la première fois, les entreprises n’étaient plus confrontées à des problèmes de production, mais à des problèmes de débouché pour leurs marchandises. Afin d’écouler ces stocks, il fallait, d’une part, que les classes aisées consomment davantage, et, d’autre part, que les ouvriers et les classes moyennes augmentent considérablement leurs consommations.
Au début des années 20, la société n’était pas composée de consommateurs, mais de travailleurs. En effet, le salarié américain se contentait de travailler dur pour acheter les biens dont il avait besoin (alimentation, logement, vêtement, etc.). Il vivait de façon frugale en respectant les principes de l’éthique protestante (valeur du travail, ascétisme moral, effort et épargne). Ses besoins satisfaits, il préférait consacrer son temps libre à des loisirs, à la lecture et aux relations sociales plutôt que d’effectuer des heures supplémentaires pour augmenter son pouvoir d’achat. Comme les travailleurs ne consommaient que ce dont ils avaient besoin, les industriels ont compris que pour écouler leurs marchandises, il fallait transformer le mode de vie frugal des Américains. La tâche était d’autant plus ardue, que l’ascétisme moral de la culture protestante l’emportait largement sur l’attrait des plaisirs immédiats de la consommation hédoniste. C’est à ce moment que le marketing entre en jeu.
-
Edward Bernays : le pionnier de la société de consommation.
Afin de transformer le comportement des Américains, les industriels ont fait appel à des agences de marketing, dont l’un des pionniers est Edward Bernays[2]. Même s’il a contribué, à sa manière, à façonner le monde dans lequel nous vivons, Bernays est beaucoup moins connu que son oncle Freud. En étudiant les travaux de son oncle, il a pris conscience que le comportement d’un individu n’était pas guidé que par sa raison, mais par des pulsions inconscientes. À partir de ce constat, Bernays a eu l’idée de transformer la consommation en moyen de contrôle et de sublimation des pulsions et des forces irrationnelles de l’Homme. Pour cela, il a eu le génie d’imaginer qu’il était possible de manipuler le comportement d’achat du consommateur en associant un produit à une émotion. Le plaisir que procure l’acte d’achat doit lui permettre de se sentir mieux après qu’avant l’achat. En permettant au consommateur d’exprimer et d’affirmer sa personnalité par l’intermédiaire d’objets marchands (vêtements, voiture, etc.), l’acte d’achat n’a plus la vocation de satisfaire des besoins essentiels, mais des besoins psychosociaux. En instrumentalisant les travaux de recherche de Freud, Bernays a élaboré des outils et des méthodes opérationnels qui ont transformé les Américains en adepte de la religion de la consommation.
-
Le marketing : un outil de guerre psychologique.
Le marketing est un outil de guerre psychologique qui a pour but de convertir les individus en adepte de la Religion de la consommation. Sa mission est d’inciter le consommateur à consommer toujours plus de biens et de services marchands. Afin d’atteindre cet objectif, les agences de marketing ont financé, d’une part, des études de marché pour connaître les besoins, les désirs et les aspirations des consommateurs et, d’autre part, des recherches en psychosociologie et en neuropsychologie pour comprendre les motivations conscientes et inconscientes du comportement d’achat du consommateur. Ces travaux leur ont permis de concevoir des outils, des méthodes et des concepts opérationnels (marketing-Mix, segmentation des marchés, socio-styles, etc.). La finalité de ces études est, d’une part, de procurer au consommateur une offre de biens et de services marchands qui répond à ses désirs, et, d’autre part, de le motiver à les acheter en manipulant ses besoins et ses circuits du plaisir et de la souffrance. Pour l’inciter à consommer toujours plus, les industriels augmentent toujours plus leurs dépenses publicitaires. Au niveau mondial, le budget moyen de la publicité se chiffre à 500 milliards de $ par ans.
-
Le rôle des théories économiques néoclassiques.
Afin de faire passer les Américains de la culture des besoins à celle des désirs, le marketing avait besoin d’un cadre théorique que la théorie économique marginaliste ou néo-classique lui a fourni. La théorie marginaliste de Jean Baptiste Say, Carl Menger, et Léon Walras entretient la confusion entre un besoin et un désir. En postulant que c’est la subjectivité et non l’objectivité des acteurs qui est à l’origine de l’évaluation de la valeur et de l’utilité d’un bien ou d’un service, les marginalistes ont contribué à élargir toujours plus l’offre de consommation marchande. En effet, la valeur d’un objet repose, d’une part, sur sa capacité à satisfaire un désir, quelle que soit son utilité, et d’autre part, sur une conception économique qui postule que « pour avoir de la valeur, un objet doit être utile et rare ». De ce fait, la valeur n’est pas inhérente au bien lui-même, mais à la perception, au désir et au jugement subjectif des acteurs. En effet, deux individus disposant de ressources équivalentes et évoluant dans un environnement similaire n’accorderont pas le même intérêt à un même objet. Un même objet peut avoir une utilité et une valeur pour l’un et aucune valeur pour l’autre.
« La valeur est toujours le résultat d’un processus d’évaluation. Le processus d’évaluation consiste à comparer l’importance de deux ensembles de biens du point de vue de l’individu qui effectue l’évaluation. L’individu qui évalue et les ensembles de biens évalués, c’est-à-dire le sujet et les objets de l’évaluation, doivent entrer comme des éléments indivisibles dans tout processus d’évaluation. » Ludwig Von Mises
La valeur d’un objet étant déterminée par la subjectivité d’un acteur, avant de fixer le prix d’un bien ou d’un service marchand, il est utile de se poser quelques questions sur ses motivations d’achat : à quel point a-t-il besoin du produit ? Combien est-il prêt à payer pour se l’offrir ? Quelles sont les conditions de la vente (rareté ou abondance) ? Par exemple, une bouteille d’eau dans le désert n’aura pas la même valeur que dans une ville.
« J’entends cette qualité qu’ont certaines choses de pouvoir nous servir, de quelque manière que ce soit. Pourquoi l’utilité d’une chose fait-elle que cette chose a de la valeur ? Parce que l’utilité qu’elle a la rend désirable, et porte les hommes à faire un sacrifice pour la posséder. On ne donne rien pour avoir ce qui n’est bon à rien ; mais on donne une certaine quantité de choses que l’on possède (une certaine quantité de pièces d’argent, par exemple) pour obtenir la chose dont on éprouve le besoin. C’est ce qui fait sa valeur. Cependant il y a des choses qui ont de la valeur et qui n’ont pas d’utilité, comme une bague au doigt, une fleur artificielle ? Vous n’entrevoyez pas l’utilité de ces choses, parce que vous n’appelez que ce qui l’est aux yeux de la raison, tandis qu’il faut entendre par ce mot tout ce qui est propre à satisfaire les besoins, les désirs de l’homme tel qu’il est. Or, sa vanité et ses passions font quelquefois naître en lui des besoins aussi impérieux que la faim. Lui seul est juge de l’importance que les choses ont pour lui, et du besoin qu’il en a. Nous n’en pouvons juger que par le prix qu’il y met : pour nous, la valeur des choses est la seule mesure de l’utilité qu’elles ont pour l’homme. Il doit donc nous suffire de leur donner de l’utilité à ses yeux, pour leur donner de la valeur. » Jean Baptiste Say [3]
Pour Jean Baptiste Say, sont utiles les choses pour lesquelles l’individu est prêt à faire un sacrifice ou à échanger pour l’obtenir. Par conséquent, pour augmenter la création de richesse et stimuler la croissance du PIB, il est indispensable d’élargir toujours plus l’offre marchande ostentatoire, indépendamment de son utilité réelle. Pour les marginalistes, la valeur d’un bien ne dépend pas de son utilité réelle, mais du prix qu’un individu est prêt à payer pour l’acquérir. Jean-J Goux a perçu les conséquences de cette théorie.
« La science économique est prête pour un nouveau saut. Elle abandonnera bientôt, sans trop de scrupule, son titre d’économie politique pour devenir économie pure. Poussant son indifférence axiologique et son mouvement d’abstraction et de démoralisation jusqu’à rejeter comme métaphysique toute question sur les raisons et déraisons de l’utilité, et sur ce qui détermine plus profondément la valeur ou la non-valeur attribuée aux choses. C’est dire que l’économie est prête pour la révolution néoclassique ou marginaliste. » Jean-Joseph Goux
En entretenant la confusion entre un besoin et un <>désir et en exploitant les désirs, par nature, illimités et insatiables, l’économie marginaliste a ouvert la porte à la société de consommation. La variété et l’abondance de biens et de services marchands sont considérées comme un progrès, indépendamment de leur utilité réelle dont on ne se préoccupe plus. Cette confusion est exploitée par les industrielles, le marketing et la publicité dont le seul objectif est de proposer toujours plus de nouveaux produits pour générer toujours plus de profits. Tant qu’un individu sera prêt à mettre le prix pour satisfaire ses désirs, la croissance économique sera assurée.
-
La naissance de la société de consommation
En 1927, 7 ans après le lancement de la campagne de transformation de la mentalité américaine, le miracle de la société de consommation était né. En transformant la société de production de masse en société de consommation de masse, les agences de marketing ont contribué activement à révolutionner la stratégie des entreprises et le mode de vie des Américains. Grâce à Bernays, l’Amérique est devenue une société de consommation destinée à satisfaire des désirs illimités et insatiables. En permettant aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés, le marketing leur a permis de réaliser des profits et de créer des emplois.
Herbert Hoower fut le premier président à considérer la consommation comme le pilier central du mode de vie américain. En effet, avec la société de consommation était née une nouvelle conception de la démocratie, de la vie en société et du contrôle des masses. Pour Hoower, la mission la plus importante d’un patriote n’était pas d’être un citoyen, mais d’être un consommateur. C’est ainsi que l’individu a perdu son statut de citoyen, au profit de celui de travailleur/consommateur. En 1929, le président Hoover publia le rapport d’une enquête qui témoignait du changement d’état d’esprit qui s’était opéré aux États-Unis en moins de 10 ans.
« L’enquête démontre de façon sûre ce que l’on avait longtemps tenu pour vrai en théorie, à savoir que les désirs sont insatiables ; qu’un désir satisfait ouvre la voie à un autre. Pour conclure, nous dirons qu’au plan économique un champ sans limites s’offre à nous ; de nouveaux besoins ouvriront sans cesse la voie à d’autres, plus nouveaux, encore, dès que les premiers seront satisfaits. […] La publicité et autres moyens promotionnels […] ont attelé la production à une puissance motrice quantifiable. […] Il semble que nous pouvons continuer à augmenter l’activité. […] Notre situation est heureuse, notre élan extraordinaire. »[4]
Ce rapport optimiste n’avait pas intégré les conséquences de la baisse de l’épargne et de la hausse prodigieuse du crédit à la consommation. En enfonçant les États-Unis dans une récession profonde, la crise de 1929 a stoppé la flambée de consommation. En se propageant à l’Europe et à l’Allemagne, cette crise provoqua l’ascension d’Hitler au pouvoir.
La Religion de la consommation et le mode de vie américain (Coca-Cola, le père Noël, etc.) ont débarqué en Europe de l’Ouest à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 50, le plan Marshall et la croissance économique ont sorti la France d’un état de pénurie dû à la guerre. En effet, durant les 30 glorieuses, les supermarchés, les outils de production modernes, les installations électriques domestiques, le téléphone, la voiture individuelle, symbole de la liberté, du progrès et de la modernité « made in USA », ont permis aux Français d’accéder à l’abondance matérielle. Comme aux États-Unis, la publicité et les médias ont bombardé massivement les Français pour les transformer en consommateurs hédonistes. À la fin des années 60, la société de consommation de masse avait envahi la France. Pour ne donner qu’un exemple, le pourcentage de ménages français propriétaires d’une voiture est passé de 22,5% en 1954 à 56,8% en 1970. Au milieu des années 70, face à la hausse du chômage provoqué par la crise pétrolière, la mission de la consommation n’était plus de générer du bien-être, mais de relancer la croissance du PIB pour créer des emplois. De ce fait, au nom de la création d’emploi, les entreprises gaspillent les ressources de la planète et menacent l’avenir de l’humanité.
Après avoir dévoilé, d’une part, les origines de l’esprit du capitalisme et de la naissance de l’argent Roi, et, d’autre part, les confusions entretenu par la Religion du travail et de la consommation, nous tenterons d’appréhender comment le langage et le mode de socialisation des familles entretiennent les cadres et les classes moyennes dans un état de servitude volontaire.
Pour accéder aux pages suivantes :
– La confusion entretenue par la Religion du travail.
– Pourquoi le langage contribue-t-il à notre servitude volontaire ?
[1] Riffikin Jeremy, La fin du travail, Paris, La découverte & Syros, 1996, page 41.
[2] Bernays Edward, Propaganda, Comment manipuler l’opinion en démocratie, Paris, Zones, 2007.
[3] Say Jean Baptiste, Catéchisme d’Économie politique, Paris, Guillaumin, page 11
[4] Riffikin Jeremy, La fin du travail, Paris, La découverte & Syros, 1996, page 46.