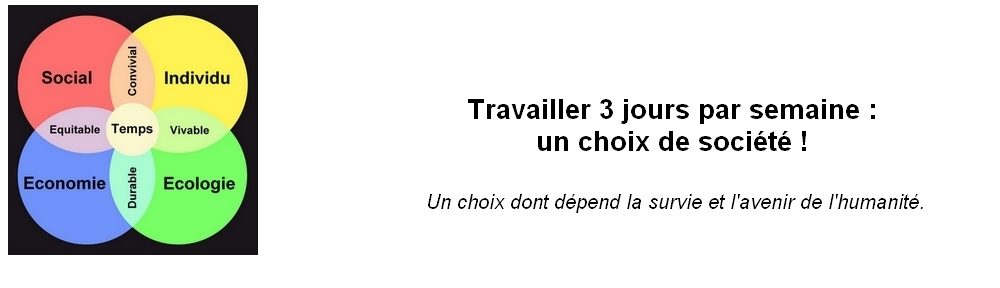L’extermination d’une partie de l’humanité nécessite la contribution active ou passive des cadres et des classes moyennes. Étant pour la plupart de braves gens sains d’esprit, ils ne souhaiteront pas participer à ce crime contre l’humanité. Afin de les inciter à y contribuer, il est indispensable de les habituer à banaliser le mal en annihilant progressivement les principes éthiques et moraux qui guident leurs conduites.
L’extermination d’une partie de l’humanité nécessite la contribution active ou passive des cadres et des classes moyennes. Étant pour la plupart de braves gens sains d’esprit, ils ne souhaiteront pas participer à ce crime contre l’humanité. Afin de les inciter à y contribuer, il est indispensable de les habituer à banaliser le mal en annihilant progressivement les principes éthiques et moraux qui guident leurs conduites.
« La banalité du mal »[1] décrit par Hannah Arendt permet de comprendre le processus qui conduit à banaliser le mal. Après l’accès au pouvoir d’Hitler en 1933, la peur d’être déporté et de perdre sa vie a motivé une partie des cadres et des fonctionnaires allemands à collaborer activement ou passivement à la déportation d’opposant politique, de résistant et de millions de juifs. Ces hommes n’étaient pas des héros, des fanatiques, des psychopathes ou des aliénés privés de volontés. Ils obéissaient docilement aux ordres et à l’idéologie raciale véhiculée par le parti, sans trop se poser de question sur la portée de leurs actes. Ils étaient, pour la plupart, des hommes moyens, banals et ordinaires comme Eichmann.
« Ce qui me frappait chez le coupable, c’était un manque de profondeur évident, et tel qu’on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu’au niveau plus profond des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu’on jugeait alors, était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n’y avait en lui ni trace de convictions idéologiques solides, ni de motivations spécifiquement malignes et la seule caractéristique notable qu’on décelait dans sa conduite, passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l’avait précédé, étaient de nature entièrement négative : ce n’était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale, il se comportait aussi bien qu’il l’avait fait sous le régime nazi, mais, en présence de situations où manquait ce genre de routine, il était désemparé, et son langage bourré de clichés produisait à la barre, comme visiblement autrefois, pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés, phrases toutes faites, code d’expression standardisée et conventionnels ont pour fonction reconnue, socialement, de protéger de la réalité, c’est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent à l’attention, de par leur existence même.[…] C’est cette absence de pensée, tellement courante dans la vie de tous les jours où l’on a à peine le temps, et pas davantage l’envie de s’arrêter pour réfléchir, qui éveilla mon intérêt. Le mal (par omission aussi bien que par action) est-il possible quand manquent non seulement les “motifs répréhensibles” (selon la terminologie légale), mais encore les motifs tout court, le moindre mouvement d’intérêt ou de volonté ? Le mal en nous est-il, de quelque façon qu’on le définisse, “ce parti de s’affirmer mauvais” et non la condition nécessaire à l’accomplissement du mal ? Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, serait-il en rapport avec notre faculté de penser ? » Hannah Arendt[2]
En 1963, l’expérience de Stanley Milgram[3] a démontré qu’en moyenne, plus de 60 % des individus sont capables de faire souffrir autrui en se soumettant à l’autorité. Pourtant, ces sujets n’étaient pas des psychopathes ou des aliénés privés de volontés. Ils n’étaient pas non plus rémunérés, soumis à des pressions physiques ou menacés de perdre leurs emplois ou leurs vies. Au contraire, ils étaient simplement soumis à une personne en blouse blanche incarnant l’autorité morale du scientifique. Malgré ce constat édifiant, cette expérience fait apparaître que 10 % à 15 % des sujets semblent rebelles à toute forme de pression psychologique.
« Plus les sujets étaient instruits, plus ils étaient enclins à se rebeller. Ceux qui exerçaient des professions touchant à l’humain (justice, médecine, enseignement par exemple) se révélaient plus contestataires que ceux qui exerçaient des professions plus techniques « engineering, sciences physiques ». » Stanley Milgram[4].
En effet, les sujets instruits et ceux qui exercent une profession touchant à l’humain sont souvent plus nombreux à refuser de se soumettre à l’autorité. Estimant être responsables de la souffrance qu’ils infligent à autrui, ils se rebellent plus souvent face à un ordre jugé immoral. Plus un individu dispose d’un niveau de jugement moral élevé, d’un esprit critique, d’un libre arbitre, d’une individualité singulière, d’une intégrité et d’une bonne estime de soi, plus il dispose de ressources psychiques pour résister à la pression exercée par une autorité ou un groupe.
À l’inverse, les sujets les moins instruits et ceux qui exercent des professions plus techniques (ingénieur, comptable, technicien, commercial, etc.) sont plus aptes à se soumettre à l’autorité et à contribuer au « sale boulot ». Comme ils attribuent la responsabilité de leurs actes à celui qui exerce l’autorité et à la victime, les sujets obéissants se sentent moins responsables. Les rouages qui contribuent à la banalisation du mal sont la peur, l’ignorance, la conduite par des pratiques quotidiennes, la cupidité, le manque d’estime de soi, l’arrêt de la pensée et l’absence d’intériorité.
La domination des élites économiques et politiques repose sur l’instrumentalisation du circuit de l’évitement de la douleur et du système inhibiteur de l’action. Lorsqu’un individu est placé dans un état de peur, d’insécurité et de stress permanent, son système limbique ne transmet plus d’information à ses lobes frontaux. Dominé par ses émotions, il est contraint de réagir sur le mode de l’affrontement, de la fuite ou de la soumission. Ne pouvant faire appel à sa raison, il perd progressivement sa liberté, son autonomie et son sens des responsabilités. Par conséquent, entretenir la peur du chômage est la stratégie la plus simple pour habituer les salariés à banaliser le mal. En effet, malgré la culpabilité et la honte, un cadre, qui a peur de perdre son emploi, son revenu, son statut social et son niveau de vie matériel, acceptera de contribuer docilement au « sale boulot » sans se poser trop de questions sur les conséquences de ses actes.
Les systèmes totalitaires reposent sur l’ignorance qui inhibe le désir de liberté, d’autonomie et de responsabilité. La connaissance étant réservée aux experts, les élites ne favorisent pas sa diffusion. Elles ne souhaitent pas que l’individu pense, mais plutôt qu’il dépense. La mission des médias est d’occuper le temps et l’esprit en diffusant des émissions de divertissement qui n’invite pas à réfléchir et à penser. La mission de l’éducation est de façonner le comportement des jeunes aux exigences des entreprises et de la consommation. Les entreprises valorisent les formations professionnelles (école de commerce, de gestion et d’ingénieur) qui conditionnent les étudiants à percevoir le monde à travers le prisme économique, à accepter l’ordre établi et à contribuer à la guerre économique. À l’inverse, ils dévalorisent, rendent optionnel ou suppriment les cours de lettre, de philosophie et de sciences humaines qui donnent des armes pour lutter contre la soumission à l’autorité et à l’embrigadement idéologique. En acceptant docilement l’autorité de l’ordre établi, l’ignorant délègue la responsabilité de ses choix de vie aux hommes politiques, aux experts, aux entreprises, aux médias et à la publicité.
« Que de détours pour dire une chose au fond si simple : il faut que le travail paye. Mais c’est une vieille habitude nationale : la France est un pays qui pense. Il n’y a guère une idéologie dont nous n’avons fait la théorie. Nous possédons dans nos bibliothèques de quoi discuter pour les siècles à venir. C’est pourquoi j’aimerais vous dire : assez pensé maintenant. Retroussons nos manches. » Christine Lagarde[5]
Le cadre a souvent la naïveté de croire que son activité professionnelle favorise l’émancipation de ses facultés intellectuelles. Dans l’imaginaire salarial, la légitimité de son autorité repose sur sa capacité à mobiliser des connaissances théoriques et des modèles mentaux complexes pour prendre des décisions rationnelles et appropriées à un problème. Les travaux de recherche de Michaël Ballé font apparaître, qu’en règle générale, le cadre prend des décisions à partir d’un modèle de raisonnement qui nécessite « le moindre effort mental »[6]. C’est-à-dire celui qui mobilise le moins de temps, d’énergie et d’effort. En pratiquant plus de 50 heures par semaine une activité professionnelle qui nécessite le « moindre effort mental », le cadre nuit gravement à la performance de l’entreprise, mais surtout, il atrophie l’exercice de sa raison et sa faculté de penser. En n’exerçant plus sa raison, il risque de devenir l’instrument actif ou passif de la banalisation du mal.
Comme l’individu aime croire qu’il contrôle sa vie, pour le manipuler, il suffit de lui donner l’illusion qu’il accomplit des actions sur sa propre initiative. Michel Foucault a fait apparaître un phénomène, qu’il a nommé la logique des pratiques[7] ou des situations. Cette logique opère sur le terrain même de la pratique, pris au sens le plus élémentaire du terme : ce que fait concrètement un individu au quotidien. Les pratiques s’organisent et s’ordonnent à l’intérieur d’un système de normes et de valeurs idéologiques qui leur confèrent une certaine forme de légitimité. Ne faisant pas intervenir la logique et la raison, la conduite des pratiques ne nécessite pas le consentement de l’individu et ne se soucie pas de le convaincre du bien-fondé d’un projet ou d’une doctrine idéologique. Au contraire, elle enseigne qu’il est parfaitement possible de conduire un individu à adhérer activement ou passivement à un projet alors même qu’il n’y consent pas « sale boulot » ou à une doctrine idéologique (Nazisme, ultra-libéralisme, etc.) qui va à l’encontre de ses convictions. En effet, placé dans une certaine situation, un individu sera conduit à se comporter conformément aux prescriptions de normes et de procédures, indépendamment de ses valeurs et de ses représentations subjectives. Par exemple, bien qu’il soit animé de valeurs humanistes et écologistes, un cadre peut, à l’occasion de sa pratique professionnelle, contribuer au « sale boulot »[8] : harceler un salarié, enfreindre le Code du travail, préparer un plan social, polluer une rivière ou détruire une forêt primaire.
Foucault fait également remarquer qu’il n’est pas nécessaire de contraindre un individu à se comporter d’une certaine manière pour atteindre un objectif donné. Au contraire, il fait apparaître l’existence d’une sorte de « conduction »[9], au sens de conduire, qu’il présente sous la formule de conduite des pratiques et des situations. Ce mécanisme est infiniment plus subtil pour obtenir certains effets que celui de la contrainte. En effet, au lieu d’utiliser la force pour contraindre un individu à obéir, il est plus judicieux de la substituer par la contrainte de la situation en jouant sur le ressort de la motivation. En le plaçant dans une certaine situation et en exploitant son besoin d’autonomie, de liberté et de responsabilité, il sera possible d’obtenir de lui une conduite conforme aux exigences prescrites. Ce qui n’exclut pas, dans certaines situations, de recourir à la contrainte. Pour cela, il suffit de placer l’individu dans une situation où il ne peut pas se comporter autrement que de la manière prescrite sous peine de tout perdre. Par exemple, le cadre qui ne se comporterait pas conformément aux attentes de l’entreprise risquerait de perdre son emploi, son statut, son revenu, ainsi que la stabilité de sa vie familiale et sociale.
La stratégie la plus subtile du management consiste à conduire un individu en le plaçant dans une situation de concurrence. Le salarié peut être convaincu que la concurrence est une bonne ou une mauvaise chose, cela ne changera rien au résultat. L’évaluation individualisée des performances et la fixation d’objectifs individuels contribuent à renforcer la concurrence entre les salariés. Les récompenses ou les punitions étant liées au résultat obtenu, pour atteindre leurs objectifs, ils sont contraints de rentrer en compétition les uns avec les autres. Le processus de concurrence intériorisé, il n’est plus utile de prescrire au salarié ce qu’il doit faire. En combinant la concurrence avec le besoin de liberté et la peur du chômage, il est possible de conduire le comportement d’un salarié en fonction des intérêts de l’entreprise sans avoir recours à la contrainte. À ce titre, la pratique quotidienne d’une activité professionnelle peut contribuer à banaliser le mal.
Pour accéder aux pages suivantes :
[1] Arendt Hannah, Eichmann a Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, 1966, Folio, 1991.
[2] Arendt Hannah, La vie de l’esprit, Paris, Presse Universitaire de France, 1981, page 21
[3] Milgram Stanley, Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
[4] Ibid, page 252.
[5] Lagarde Christine, « Présentation du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat », Assemblée nationale, mardi 10 juillet 2007.
[6] Michaêl Ballé, La loi du moindre effort mental, article Sciences Humaines n° 128, juin 2002, page 36 à 39
[7] Foucault Michel, « Le pouvoir comment s’exerce t-il ? » in Colas D., La pensée politique, Paris, Larousse, 1992
[8] Dejours Christophe, Souffrance en France : banalisation de l’injustice sociale, Paris, Ed du Seuil, 1998, page 101.
[9] Foucault Michel, Op. Cit.