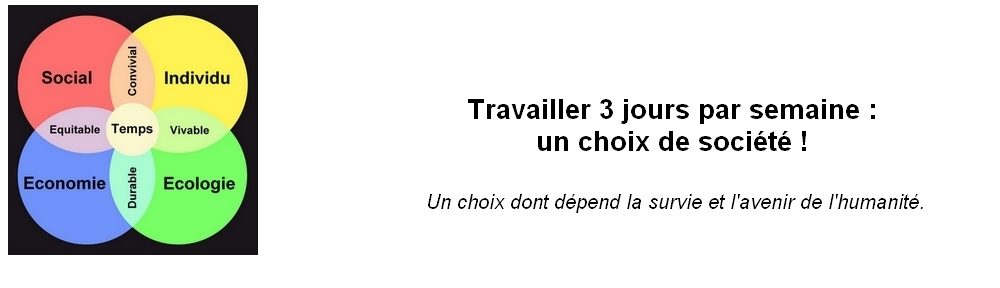La vie sera possible tant que la biocapacité de la planète ne sera pas épuisée. C’est à dire, tant que la nature sera capable d’absorber les conséquences de son exploitation. Étant donné que la consommation ostentatoire des ménages, l’industrialisation et l’agriculture intensive provoquent la désertification des sols, la rareté de l’eau, la disparition de la biodiversité, l’asphyxie de la planète et le réchauffement du climat, la croissance du PIB sera viable tant qu’elle ne dépassera pas les capacités d’absorption de la nature.
Trois indicateurs permettent de calculer l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. La biocapacité mesure la capacité de l’écosystème à supporter durablement notre mode de vie. L’empreinte écologique mesure le nombre de planètes nécessaires pour assurer le mode de vie d’un individu, d’un pays et de la population mondiale. L’indicateur d’équivalent carbone permet de calculer la capacité d’absorption de carbone sans menacer la biocapacité de la planète. En combinant ces trois indicateurs, il est possible de matérialiser l’impact du développement économique et de notre mode de vie. Le graphique ci-dessous montre l’empreinte écologique et la biocapacité mondiale par région en 2008[1].
Empreinte écologique et biocapacité par région, en 2008

-Source : Rapport Planète Vivante 2012 de WWF
De 1961 à 2008, la biocapacité mondiale disponible par personne est passée de 3,2 à 1,8 hectare par habitant (hag/hab) et l’empreinte écologique de 0,6 à 2,7 hag/hab. Sur 47 ans, tandis que la biocapacité diminuait de 1,4 hag/hab, l’empreinte augmentait de 2,1 hag/hab. Désormais, chaque être humain ne dispose plus que de 1,8 hectare pour assurer sa survie. Si en 1961, il fallait 0,6 planète pour assurer la survie de l’humanité, en 2008 il en faut désormais 2,7. Le problème, c’est que nous n’en avons qu’une seule. Afin de la réduire, il apparaît nécessaire de commencer par identifier les régions du monde qui ont l’empreinte la plus élevée. En 2008, celles qui avaient la plus élevée étaient l’Amérique du Nord (7,1 hag/hab) et l’Union européenne (4,7 hag/hab). Avec 14,7 hag/hab, le Luxembourg, dont les principales activités économiques sont la finance et l’optimisation fiscale (LuxLeaks), détient l’empreinte la plus élevée au monde. Ces régions, qui comprennent 12,4 % de la population mondiale, ont donc déjà très largement dépassé les capacités d’absorption de leurs territoires. Si tous les habitants de la planète souhaitaient vivre comme un Européen ou un Américain du Nord, il faudrait plus de quatre, voire sept planètes pour assurer ce mode de vie matérialiste. S’ils souhaitaient tous vivre comme un Luxembourgeois, il en faudrait quatorze. Il apparaît donc évident que pour éviter une catastrophe écologique et climatique annoncée, ce sont les populations de ces régions du monde qui ont le devoir et la responsabilité de commencer par réduire considérablement leur empreinte écologique.
L’empreinte écologique de l’Asie Pacifique (Inde, Chine, Indonésie, etc.) et de l’Afrique, qui représentent à eux deux 69,8 % de la population mondiale, était de 1,6 et de 1,45 hag/hab. Si les deux régions les plus peuplées atteignaient la biocapacité de leur territoire, l’empreinte mondiale risquerait d’atteindre plus de trois planètes. En ce qui concerne les autres pays européens, l’Amérique Latine, le moyen Orient et l’Asie Centrale, qui comprennent 17,9 % de la population mondiale, ils ont désormais un déficit compris entre 0,7 et 2,2 hag/hab. Tandis qu’en 2003, ces régions du monde n’avaient pas encore dépassé leur biocapacité, en 2008, à cause de la surpopulation et du développement économique, elles les ont épuisées. Avec une empreinte écologique de 11,7 hag/hab, le pays du moyen Orient qui se distingue une fois de plus est le Qatar. Étant donné qu’il y a un lien étroit entre le développement économique et l’empreinte écologique, la croissance du PIB est responsable du dépassement de la biocapacité. Les capacités d’absorption de la planète étant limitées, la croissance illimitée du PIB accélère le réchauffement du climat et l’épuisement des ressources naturelles et biologiques. Pour le dire plus simplement, une croissance illimitée dans un monde limité n’est pas viable à moyen et long terme.
Le GIEC a calculé que la capacité d’absorption de l’écosystème de la planète était de 3 000 milliards de tonnes d’équivalents carbone par an. En fonction de la population mondiale, cet indice permet de calculer le nombre de kilogrammes de carbone qu’un individu peut consommer par an sans aggraver son impact sur l’environnement. Afin d’éviter les catastrophes climatiques et environnementales annoncées, il existe donc deux options : limiter la consommation d’équivalent carbone ou limiter la population mondiale. La première option consiste à limiter la consommation d’équivalent carbone de chaque habitant de la planète. Étant donné qu’en 2013, la population mondiale comprenait 7,1 milliards de personnes, pour ne pas dépasser 3 000 milliards de tonnes par an, le nombre de kilogrammes de carbone par habitant devra être limité à 420 kg. L’empreinte carbone des pays industrialisés étant comprise entre 2 000 et 4 400 kg, c’est aux populations de ces pays que reviendra le devoir et la responsabilité de tendre volontairement, et dans un délai très cours, vers un mode de vie plus sobre, tel que la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse.
La seconde option consiste à limiter la population mondiale. Si le mode de vie matérialiste des pays occidentaux n’est toujours pas négociable et que la population mondiale souhaite consommer comme un Français, soit 2 000 kg/hab, il faudrait la limiter à 1,5 milliard d’habitants. Si, elle souhaitait consommer comme un Américain, soit 4 500 kg/hab, il faudrait la limiter à 666 millions. En fonction de ce choix, il sera nécessaire de commencer par supprimer très rapidement et d’un coup brutal un surplus compris entre 5,6 ou 6,5 milliards de personnes. Le mode de vie des populations des pays en développement se limitant souvent à la survie, la responsabilité de ce choix éthique et moral incombe donc aux élites économiques et politiques, ainsi qu’aux cadres et aux classes moyennes des pays industrialisés.
-
Comment inciter les cadres et les classes moyennes à banaliser le mal ?
L’extermination d’une partie de l’humanité nécessite la contribution active ou passive des cadres et des classes moyennes. Étant pour la plupart de braves gens sains d’esprit, ils ne souhaiteront pas participer à ce crime contre l’humanité. Afin de les inciter à y contribuer, il est indispensable de les habituer à banaliser le mal en annihilant progressivement les principes éthiques et moraux qui guident leurs conduites. Le rapport sur « la banalité du mal » de Hannah Arendt[2] permet d’appréhender le processus qui conduit à banaliser le mal.
Après l’accès au pouvoir d’Hitler en 1933, la peur d’être déporté et de perdre sa vie a motivé une partie des cadres et des fonctionnaires allemands à collaborer activement ou passivement à la déportation d’opposant politique, de résistant et de millions de juifs. Ces hommes n’étaient pas des fanatiques, des psychopathes ou des aliénés privés de volontés. Ils obéissaient docilement aux ordres et à l’idéologie raciale véhiculée par le parti, sans trop se poser de questions sur la portée de leurs actes. Ils étaient, pour la plupart, des hommes moyens, banals et ordinaires comme Eichmann.
« Ce qui me frappait chez le coupable, c’était un manque de profondeur évident, et tel qu’on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu’au niveau plus profond des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu’on jugeait alors, était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n’y avait en lui ni trace de convictions idéologiques solides, ni de motivations spécifiquement malignes et la seule caractéristique notable qu’on décelait dans sa conduite, passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l’avait précédé, étaient de nature entièrement négative : ce n’était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale, il se comportait aussi bien qu’il l’avait fait sous le régime nazi, mais, en présence de situations où manquait ce genre de routine, il était désemparé, et son langage bourré de clichés produisait à la barre, comme visiblement autrefois, pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés, phrases toutes faites, codes d’expression standardisés et conventionnels ont pour fonction reconnue, socialement, de protéger de la réalité, c’est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent à l’attention, de par leur existence même.[…] C’est cette absence de pensée, tellement courante dans la vie de tous les jours où l’on a à peine le temps, et pas davantage l’envie de s’arrêter pour réfléchir, qui éveilla mon intérêt. Le mal (par omission aussi bien que par action) est-il possible quand manquent non seulement les “motifs répréhensibles” (selon la terminologie légale), mais encore les motifs tout court, le moindre mouvement d’intérêt ou de volonté ? Le mal en nous est-il, de quelque façon qu’on le définisse, “ce parti de s’affirmer mauvais” et non la condition nécessaire à l’accomplissement du mal ? Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, serait-il en rapport avec notre faculté de penser ? »[3]
En 1963, l’expérience sur « la soumission à l’autorité » de Stanley Milgram[4] a démontré que plus de 60 % de la population est capable de faire souffrir autrui en se soumettant à l’autorité. Pourtant, les sujets de ces expériences n’étaient pas des psychopathes ou des aliénés privés de volontés. Ils n’étaient pas non plus rémunérés, soumis à des pressions physiques ou menacés de perdre leurs emplois ou leurs vies. Au contraire, ils étaient simplement soumis à une personne en blouse blanche incarnant l’autorité morale du scientifique.
Expérience de Milgram-Soumission à l’autorité… par CollectifAmaruka
Malgré ce constat édifiant, cette expérience fait apparaître que 10 % à 15 % des sujets semblent rebelles à toute forme de pression psychologique. « Plus les sujets étaient instruits, plus ils étaient enclins à se rebeller. Ceux qui exerçaient des professions touchant à l’humain (justice, médecine, enseignement par exemple) se révélaient plus contestataires que ceux qui exerçaient des professions plus techniques (engineering, sciences physiques). »[5]
En effet, les sujets instruits et ceux qui exercent une profession touchant à l’humain sont souvent plus nombreux à refuser de se soumettre à l’autorité. Estimant être responsables de la souffrance qu’ils infligent à autrui, ils se rebellent plus souvent face à un ordre jugé immoral. Plus un individu dispose d’un niveau de jugement moral élevé, d’un esprit critique, d’un libre arbitre, d’une individualité singulière, d’une intégrité et d’une bonne estime de soi, plus il dispose de ressources psychiques pour résister à la pression exercée par une autorité ou un groupe. À l’inverse, les sujets les moins instruits et ceux qui exercent des professions plus techniques (ingénieur, comptable, technicien, commercial, etc.) sont plus aptes à se soumettre à l’autorité et à contribuer au « sale boulot ». Étant donné qu’ils attribuent la responsabilité de leurs actes à celui qui exerce l’autorité et à la victime, les sujets obéissants se sentent moins responsables. Les rouages qui contribuent à la banalisation du mal sont la peur, l’ignorance, la conduite des pratiques, la cupidité, le manque d’estime de soi, l’arrêt de la pensée et l’absence d’intériorité.
La domination des élites économiques et politiques repose sur l’instrumentalisation du circuit de l’évitement de la douleur et du système inhibiteur de l’action. Lorsqu’un individu est placé dans un état de peur, d’insécurité et de stress permanent, son système limbique ne transmet plus d’information à ses lobes frontaux. Dominé par ses émotions, il est contraint de réagir sur le mode de l’affrontement, de la fuite ou de la soumission. Ne pouvant faire appel à sa raison, il perd progressivement sa liberté, son autonomie et son sens des responsabilités. Par conséquent, entretenir la peur du chômage est la stratégie la plus simple pour habituer les salariés à banaliser le mal. En effet, malgré la culpabilité et la honte, pour ne pas perdre son emploi, son revenu, son statut social et son niveau de vie matériel, un cadre acceptera de contribuer docilement au « sale boulot » sans se poser trop de questions sur les conséquences de ses actes.
Les systèmes totalitaires reposent sur l’ignorance qui inhibe le désir de liberté, d’autonomie et de responsabilité. La connaissance étant réservée aux experts, les élites ne favorisent pas sa diffusion. Elles ne souhaitent pas que l’individu pense, mais plutôt qu’il dépense. La mission des médias est d’occuper le temps et l’esprit en diffusant des émissions de divertissement qui n’invite pas à réfléchir et à penser. La mission de l’éducation est de façonner le comportement des jeunes aux exigences des entreprises et de la consommation. Les entreprises valorisent les formations professionnelles (école de commerce, de gestion et d’ingénieur) qui conditionnent les étudiants à percevoir le monde à travers le prisme économique, à accepter l’ordre établi et à contribuer à la guerre économique. À l’inverse, ils dévalorisent, rendent optionnel ou suppriment les cours de lettre, de philosophie et de sciences humaines qui donnent des armes pour lutter contre la soumission à l’autorité et à l’embrigadement idéologique. Comme l’a fait remarquer Christine Lagarde lors de sa présentation du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du mardi 10 juillet 2007 « Que de détours pour dire une chose au fond si simple : il faut que le travail paye. Mais c’est une vieille habitude nationale : la France est un pays qui pense. Il n’y a guère une idéologie dont nous n’avons fait la théorie. Nous possédons dans nos bibliothèques de quoi discuter pour les siècles à venir. C’est pourquoi j’aimerais vous dire : assez pensé maintenant. Retroussons nos manches. »[6] En acceptant docilement l’autorité de l’ordre établi, l’ignorant délègue la responsabilité de ses choix de vie aux hommes politiques, aux experts, aux entreprises, aux médias et à la publicité.
Le cadre a souvent la naïveté de croire que son activité professionnelle favorise le développement de ses facultés intellectuelles. Dans l’imaginaire salarial, la légitimité de son autorité repose sur sa capacité à mobiliser des connaissances théoriques et des modèles mentaux complexes pour prendre des décisions rationnelles et appropriées à un problème. Les travaux de recherche de Michaël Ballé font apparaître, qu’en règle générale, le cadre prend des décisions à partir d’un modèle de raisonnement qui nécessite « le moindre effort mental »[7]. C’est-à-dire la décision qui mobilise le moins de temps, d’énergie et d’effort. En pratiquant plus de 50 heures par semaine une activité professionnelle qui nécessite le « moindre effort mental », le cadre nuit gravement à la performance de l’entreprise, mais surtout, il atrophie l’exercice de sa raison et sa faculté de penser. En n’exerçant plus sa raison, il risque de devenir l’instrument actif ou passif de la banalisation du mal.
Étant donné que l’individu aime croire qu’il contrôle sa vie, pour le manipuler, il suffit de lui donner l’illusion qu’il accomplit des actions de sa propre initiative. Michel Foucault a fait apparaître un phénomène qu’il a nommé la logique des pratiques[8]. Cette logique opère sur le terrain même de la pratique, pris au sens le plus élémentaire du terme : ce que fait concrètement un individu au quotidien. « Il s’agit d’établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les individus, d’instaurer les communications utiles, d’interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l’apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc, pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. »[9] Les pratiques s’organisent et s’ordonnent à l’intérieur d’un système de normes, de valeurs et de procédures qui leur confèrent une certaine forme de légitimité. Ne faisant pas intervenir la logique et la raison, non seulement la conduite des pratiques ne nécessite pas le consentement de l’individu, mais en plus, elle ne se soucie pas de le convaincre du bien-fondé d’un projet ou d’une action. En effet, elle enseigne qu’il est parfaitement possible de conduire un salarié à se comporter conformément aux normes et aux procédures prescrites, indépendamment de ses valeurs, de ses croyances, de ses convictions et de ses représentations subjectives. Bien qu’il soit animé de valeurs humanistes et écologistes, dans le contexte de sa pratique professionnelle, un cadre sain d’esprit peut contribuer activement ou passivement au « sale boulot »[10] : harceler un salarié, enfreindre le Code du travail, préparer un plan social, polluer une rivière, etc.
Michel Foucault fait également remarquer qu’il n’est pas nécessaire de contraindre un individu à se comporter d’une certaine manière pour atteindre un objectif donné, alors même qu’il n’y consent pas. Il fait apparaître l’existence d’une sorte de « conduction »[11], au sens de conduire, qu’il présente sous la formule de conduite des pratiques et des situations. Ce mécanisme est infiniment plus subtil pour obtenir certains effets que celui de la contrainte. En effet, au lieu d’utiliser la force pour contraindre un individu à obéir, il est plus judicieux de la substituer par la contrainte de la situation en jouant sur le ressort de la motivation. En le plaçant dans une certaine situation et en combinant la peur du chômage avec son besoin d’autonomie, de liberté et de responsabilité, il sera possible d’obtenir de lui une conduite conforme aux exigences prescrites.
La stratégie la plus subtile consiste à placer un cadre dans une situation de compétition. Même s’il est convaincu que la compétition n’est pas une solution en soi, cela ne changera rien au résultat. En combinant subtilement un climat de compétition avec la recherche du plaisir et l’évitement de la douleur, il est possible de conduire son comportement en fonction des intérêts de l’entreprise sans avoir recours à la contrainte. Pour inciter un cadre à atteindre les objectifs individuels qui lui ont été proposés, voire imposés, lors de l’évaluation individualisée des performances, il suffit de le maintenir dans un climat de compétition et de le récompenser ou de le punir en fonction de ses résultats. Le climat de concurrence ayant été intériorisé, il ne sera plus utile de lui prescrire ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs. Ce qui n’exclut pas, dans certaines situations, de recourir à la contrainte. Pour cela, il suffit de le placer dans une situation où il ne peut pas se comporter autrement que de la manière prescrite sous peine de tout perdre. Par exemple, le cadre qui ne se comporterait pas conformément aux attentes de l’entreprise ou qui n’atteindrait pas ses objectifs risquerait de perdre son emploi, son statut, son revenu, ainsi que la stabilité de sa vie familiale et sociale. En prescrivant les objectifs que le cadre doit atteindre chaque jour, chaque mois et chaque année, l’entreprise structure son existence. Cet emploi du temps lui évite de s’ennuyer et de se poser trop de questions sur le sens de ses actes et de sa propre vie. Ce processus quotidien contribue à entretenir son état de « servitude volontaire ». À ce titre, la pratique quotidienne d’une activité professionnelle peut contribuer à banaliser le mal.
- Pourquoi l’activité professionnelle contribuerait-elle à banaliser le mal ?
Les travaux de Christophe Dejours mettent en évidence les raisons pour lesquelles l’activité professionnelle contribue à banaliser le mal. « Ma thèse est que le dénominateur commun à toutes ces personnes, c’est le travail, et que, à partir de la psychodynamique du rapport au travail, on peut, peut-être, comprendre comment la “banalisation du mal” a été possible. »[12] En effet, les nouvelles stratégies de management placent les salariés dans des pratiques qui les habituent progressivement à collaborer activement ou passivement à la banalisation du mal. Les clefs de voûte de cette stratégie sont la peur du chômage et l’évaluation individuelle des performances.
Le sentiment d’insécurité lié à la peur du chômage entretient un climat de compétition à outrance entre les salariés. En incitant à des pratiques déloyales, l’évaluation individuelle des performances contribue à rompre les liens de solidarité. La collaboration active ou passive à ce système peut prendre la forme du « sale boulot » (harceler un salarié, enfreindre le Code du travail, préparer un plan social, etc.) et de stratégies d’évitement (nier la souffrance d’autrui, obéir aux ordres, la normopathie, etc.). En épuisant l’énergie vitale, le corps et les capacités intellectuelles du salarié, ces pratiques quotidiennes menacent son équilibre physique et psychique. En s’attaquant à la dignité, à l’honneur et aux racines de son humanité, et en contribuant à son désengagement éthique et moral, ces pratiques dégradent les conditions de travail et entretiennent un état de tension propice à la banalisation du mal. Pour faire face à cette situation, l’ouvrier et le cadre mettent en œuvre de multiples stratégies de défense individuelle consistant à engourdir et à arrêter la pensée.
L’ouvrier a peur de ne pas tenir l’accélération du rythme de son « travail répétitif sous contrainte »[13] et des maladies liées à ses conditions de travail. Il souffre de perdre ses facultés mentales et de se transformer en automate ou en simple « animal laborant »[14]. Ayant le sentiment d’être dépossédé de soi, il est également angoissé par la vacuité de son existence. Afin de fuir la peur, l’angoisse et la souffrance, il évite de penser à sa condition de vie. Pour cela, il concentre toute son attention sur l’activité répétitive prescrite ou il accélère, sur sa propre initiative, son rythme de travail. En contribuant à son épuisement physique et nerveux, la surcharge de travail contribue à amoindrir sa faculté de penser et de raisonner. L’expérience professionnelle de Charly Boyandjian illustre parfaitement ce processus. « Intellectuellement, tu ne vaux plus rien, pour la bonne raison que tu ne peux pas faire l’effort physique d’écouter un autre et de discuter ; donc tu es vachement autoritaire. Au bout d’un moment, tu arrives à être tellement crevé que ce n’est plus ton esprit qui marche, mais des flashes publicitaires. »[15]
Le cadre a peur de ne pas être à la hauteur de sa fonction, de ne pas atteindre ses objectifs inaccessibles, d’une surcharge de travail, d’être contraint au « sale boulot », d’une mutation forcée, d’une sanction, ou d’un licenciement. En exerçant trop son esprit critique sur les conséquences économiques, politiques, sociales, écologiques et climatiques de son implication, il risquerait de remettre en question son engagement dans la guerre économique. Afin d’éviter de se confronter à la peur, à l’angoisse, à la honte et à la culpabilité qui l’empêcheraient de remplir sa mission, il évite de trop penser. Pour engourdir sa conscience morale, il intensifie son rythme de travail et son implication professionnelle. L’activisme et l’addiction à l’activité professionnelle sont parfois les symptômes de la fuite des angoisses existentielles ou du refoulement des sentiments de honte et de culpabilité d’avoir contribué au sale boulot. Avec le temps, l’activisme se transforme en drogue dont il est dépendant pour ne pas s’effondrer.
Les stratégies mises en œuvre pour réprimer la pensée consomment beaucoup d’énergie. Afin de ne pas être contraint de la réprimer en permanence, dans sa vie privée, le salarié finit par éviter de trop penser. Au lieu de pratiquer des activités favorables à son émancipation, il choisira des activités destinées à l’épuiser et à engourdir sa pensée : regarder la télévision, faire du sport, s’éclater en boîte, se divertir ou s’oublier dans des beuveries. En le maintenant dans un état régressif et infantile, les médias, les divertissements, la consommation et la pratique quotidienne d’une activité professionnelle contribuent à banaliser le mal.
Ces stratégies défensives ont des répercussions sur le processus démocratique. En effet, la répression quotidienne de la pensée, associée à la peur, à l’ignorance, à la cupidité, au manque d’estime de soi et à l’absence d’intériorité est un instrument de contrôle social qui aboutit à la « servitude volontaire »[16]. En habituant le salarié à se considérer comme un simple exécutant, l’activité professionnelle lui permet de ne pas se sentir responsable de ses actes. À terme, comme l’explique Stanley Milgram, ce processus conduit à la perte totale des libertés individuelles et collectives et, pour finir, à un processus totalitaire. « L’obéissance aveugle consiste dans le fait qu’une personne en vient à se considérer comme l’instrument destiné à exécuter les volontés d’une autre personne, ce qui, par voie de conséquence, la décharge à ses yeux de toute responsabilité. La disparition du sens de la responsabilité personnelle est de très loin la conséquence la plus grave de la soumission à l’autorité. […] En mettant à la portée de l’homme des moyens d’agression et de destruction qui peuvent être utilisés à une certaine distance de la victime, sans besoin de la voir ni de souffrir l’impact de ses réactions, la technologie moderne a créé une distanciation qui tend à affaiblir des mécanismes d’inhibition dans l’exercice de l’agression et de la violence. »[17] Étant habitué à se considérer comme un simple instrument, le salarié acceptera progressivement de contribuer au sale boulot et à des pratiques que la morale réprouve. Grâce au progrès technique, la guerre a gagné en efficacité et en barbarie. En permettant de tuer à distance sans ressentir la souffrance de la victime, les armes modernes affaiblissent le sentiment de culpabilité et l’inhibition à faire souffrir autrui.
Au même titre que la classe moyenne des pays occidentaux, la classe moyenne chinoise, indienne et brésilienne et demain africaine souhaite également satisfaire leurs besoins d’appartenance et d’estime par l’intermédiaire de la consommation ostentatoire. Étant donné que les ressources naturelles de qualité, les ressources énergétiques et les stocks de matières premières de la planète sont limités et que le mode de vie occidental n’est pas négociable, les États-Unis et l’Europe risquent de précipiter les pays qui ont adhéré à l’OTAN dans une guerre contre l’Iran, la Chine et la Russie. La guerre n’est pas la seule menace qui risque de conduire l’humanité à sa perte. Les capacités d’absorption de la planète étant limitées, la croissance illimitée du PIB et la consommation ostentatoire accélèrent le processus de réchauffement climatique et d’épuisement des ressources naturelles de la planète. Afin de compenser leurs vies gâchées à travailler, les cadres et les classes moyennes des pays industrialisés consomment toujours plus de biens et de services ostentatoires. En obéissant aveuglément à l’idéologie ultra-libérale, au discours sur la guerre économique et au dogme de la croissance du PIB, ils menacent la qualité de vie, le processus démocratique et la survie des générations présentes et à venir. Que ce soit à cause de la guerre ou de la consommation, ils contribuent activement ou passivement au génocide de l’humanité.
Afin d’éviter cette catastrophe annoncée, il est indispensable de dénoncer, dès maintenant, les principaux responsables. Afin de lutter contre la hausse du chômage, les gouvernements de droite et de gauche, les économiques et les industrielles proposent uniquement de relancer la croissance du PIB. Ces catastrophes écologiques et climatiques annoncées étant provoquées par la croissance du PIB, ce sont les décideurs économiques et politiques qui devront endosser la responsabilité de ce choix. Afin de créer des emplois et de lutter contre le réchauffement climatique, ils proposent le développement durable et le miracle de la croissance verte. Malgré ces déclarations d’intention, ils n’interdisent pas l’obsolescence programmée des produits, l’accélération du rythme de la mode vestimentaire, la sortie de nouveaux modèles de voiture chaque année, l’accélération des innovations techniques des produits, les délocalisations dans des pays qui ne respectent pas les normes environnementales, etc. La liste des contradictions et des paradoxes du développement durable et de cette soi-disant croissance verte est trop longue pour être énumérée.
En étudiant les conséquences de la croissance du PIB de manière globale, nous arrivons à la conclusion qu’au début du 21e siècle, la relance sans limites et sans fin de la croissance sur une planète limitée n’est plus la solution envisageable pour supprimer le chômage. Par conséquent, au nom du principe de précaution, il est indispensable que le gouvernement français, les gouvernements des pays industrialisés, les économistes et les industrielles envisagent sérieusement la solution de la réduction du temps de travail.
Pour accéder aux pages suivantes :
– La réduction du temps de travail peut-elle supprimer le chômage ?
[3] Arendt Hannah, La vie de l’esprit, Paris, Presse Universitaire de France, 1981, page 21
[4] Milgram Stanley, Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
[5] Milgram Stanley, Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974, page 252.
[9] Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, éditions Gallimard, 1975, page 168.
[14] Arendt Hannah, Les conditions de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983.
[16] La Boëtie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, 1983.
[17] Milgram Stanley, Soumission à l’autorité, paris Calman Lévy de 1974.