Jean-Christophe Giuliani
Pour les hommes politiques et les économistes ultra-libéraux, les 5,9 millions d’actifs sans emploi sont dus au choc pétrolier de 1973, aux charges salariales qui pèsent sur la compétitivité des entreprises et à la faiblesse du taux de croissance du PIB. Ces explications un peu simplistes évoquent rarement le rôle des gains de productivité. Comme l’expliquait John Maynard Keynes en 1933, « Nous sommes atteints d’un nouveau mal, dont certains lecteurs ne connaissent peut-être pas encore le nom – le chômage technologique. Il désigne le chômage causé par la découverte de procédés nouveaux qui économisent la main-d’œuvre alors que la découverte de nouveaux débouchés pour celle-ci s’avère un peu plus lente. »[48] Afin de mieux appréhender les liens qui unissent la réduction de la durée moyenne du temps de travail, la croissance du PIB et le chômage, j’aborderai les causes, les modes de calcul et les conséquences de la productivité horaire, ainsi que les enjeux du partage de la valeur ajoutée générée par ces gains.
Quelles sont les causes des gains de productivité ?
Les gains de productivité sont générés par le progrès technique et l’organisation du travail. Ces innovations provoquent une transformation des moyens et des méthodes de production, des produits, des marchés et des structures de l’économie.
Le premier secteur d’activité qui a bénéficié des gains de productivité est celui de l’agriculture. Le progrès des outils de production agricole (tracteurs, charrues, moissonneuses-batteuses, etc…) a permis de réduire la durée du travail et le nombre d’ouvriers agricoles. Ces gains ont libéré la main-d’œuvre indispensable à l’essor de l’industrie et des services marchands. En permettant de produire plus avec moins de temps de travail et de main-d’œuvre, le progrès des outils de production industrielle (usines numériques, robots, etc…) a généré d’importants gains de productivité. L’introduction des robots a permis de remplacer les ouvriers spécialisés (OS) par des techniciens qualifiés chargés de la maintenance et de l’entretien des machines. L’exemple de l’entrepris Solarwatt illustre le lien entre le progrès des outils de production et les gains de productivité.
L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) : les ordinateurs, les téléphones mobiles, la visioconférence, les logiciels de traitement de l’information (ERP, CAO, FAO, CGDT, etc…) et les réseaux de circulations de l’information (semi-conducteurs, puces RFID, Internet, etc…) ont permis d’accélérer la circulation, la collecte et le traitement de l’information. Le progrès des moyens de transport (voiture, train, avion, cargo, tanker, etc…) et des infrastructures (autoroute, port, aéroport, ligne à grande vitesse, gazoduc, etc…) ont permis d’accélérer la circulation des voyageurs, des salariés, des matières premières et des marchandises au niveau local, national et mondial. Tandis que les TIC permettent de réduire la durée et le coût de la circulation de l’information, les moyens de transport modernes réduisent ceux des transports de marchandises. En se cumulant avec la suppression des droits de douane, qui ont débuté avec les accords du GATT[49] (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), ces baisses de coûts ont favorisé les échanges internationaux, la mondialisation de l’économie et la délocalisation des entreprises.
Les gains de productivités sont également dus aux multiples méthodes d’organisation du travail (Taylorisme, Fordisme, Toyotisme, Lean management[50], KAIZEN[51], méthode projet, etc…), qui donnent aux consultants en organisation les moyens de restructurer la production et les services. Le Toyotisme, qui consiste à produire à flux tendu et à limiter les stocks à zéro, nécessite l’intégration et la synchronisation des outils de production, des systèmes de suivis et de traitement de l’information et de la logistique.
En se combinant, le progrès technique et l’organisation du travail permettent d’augmenter la productivité horaire des entreprises.
-
Comment calculer la productivité horaire ?
La productivité mesure le rapport entre une production et la quantité de facteurs (capital, effectifs et heures de travail) mis en œuvre pour la réaliser. Elle peut mesurer la productivité physique du travail, la productivité du capital, la productivité du travail et la productivité horaire du travail.
– La productivité physique du travail mesure la quantité produite par une unité de facteur.
 Par exemple, il est possible de calculer le rendement d’un salarié (nombre de pièces réalisées par un salarié pendant une heure de travail) ou d’une machine (nombre de pièces réalisées par une machine pendant une heure). Si 100 salariés produisent 10 000 pièces, la productivité du travail sera de 10 000/100 = 100 pièces par salarié. Chaque salarié produit en moyenne 100 pièces.
Par exemple, il est possible de calculer le rendement d’un salarié (nombre de pièces réalisées par un salarié pendant une heure de travail) ou d’une machine (nombre de pièces réalisées par une machine pendant une heure). Si 100 salariés produisent 10 000 pièces, la productivité du travail sera de 10 000/100 = 100 pièces par salarié. Chaque salarié produit en moyenne 100 pièces.
– La productivité du facteur capital mesure la valeur ajoutée (VA) générée par 1 € investi.
 Par exemple, si un capital de 10 000 € génère une VA de 100 000 €, la productivité du capital sera de 100 000/10 000 = 10 €. Chaque euro investi génère en moyenne 10 € de valeur ajoutée.
Par exemple, si un capital de 10 000 € génère une VA de 100 000 €, la productivité du capital sera de 100 000/10 000 = 10 €. Chaque euro investi génère en moyenne 10 € de valeur ajoutée.
– La productivité du travail mesure la valeur ajoutée produite par un salarié.
 Par exemple, si 100 salariés génèrent 100 000 € de VA, la productivité du travail sera de 100 000/100 = 1 000 € par salarié. Chaque salarié génère en moyenne 1 000 € de valeur ajoutée.
Par exemple, si 100 salariés génèrent 100 000 € de VA, la productivité du travail sera de 100 000/100 = 1 000 € par salarié. Chaque salarié génère en moyenne 1 000 € de valeur ajoutée.
– La productivité horaire du travail mesure la VA générée par le nombre d’heures de travail.
 Par exemple, si 5 000 heures de travail génèrent 100 000 €, la productivité horaire du travail sera de 100 000/5 000 = 20 € de l’heure. Chaque heure de travail, génère en moyenne 20 € de VA.
Par exemple, si 5 000 heures de travail génèrent 100 000 €, la productivité horaire du travail sera de 100 000/5 000 = 20 € de l’heure. Chaque heure de travail, génère en moyenne 20 € de VA.
– La productivité horaire du travail (effectifs x durées moyennes travail) mesure la valeur ajoutée générée par le nombre d’heures de travail.
![]() Par exemple, si 100 salariés, qui travaillent en moyenne 50 heures, génèrent une valeur ajoutée de 100 000 €, la productivité horaire du travail sera de 100 000/(100 x 50) = 20 € par heure de travail. Chaque heure de travail d’un salarié génère en moyenne 20 € de valeur ajoutée.
Par exemple, si 100 salariés, qui travaillent en moyenne 50 heures, génèrent une valeur ajoutée de 100 000 €, la productivité horaire du travail sera de 100 000/(100 x 50) = 20 € par heure de travail. Chaque heure de travail d’un salarié génère en moyenne 20 € de valeur ajoutée.
Puisqu’elle permet de mesurer la performance d’un salarié, d’un atelier, d’une entreprise ou d’un pays, la productivité est un indicateur majeur de l’économie. Le graphique ci-dessous compare le taux de croissance de la productivité horaire avec celle de 1 heure de travail de 1950 à 2013.
 – Source : Insee, 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche, comptes nationaux, Op.Cit, (h)
– Source : Insee, 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche, comptes nationaux, Op.Cit, (h)
– Source : Insee, 6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés[52], (VA).
L’analyse de ce graphique fait apparaître que de 1950 à 2013, tandis que la valeur ajoutée moyenne générée par 1 heure de travail passait de 5,9 € à 46,1 €, le taux de croissance des gains de productivité passait de 9,1 % à 0,5 %. Le taux de croissance étant inférieur de 8,4 points, la VA générée par 1 heure de travail entre 2012 et 2013 était de 0,23 €, soit 2,1 fois moins élevée que celle générée entre 1949 et 1950 qui était de 0,49 €. Pourtant, à taux de croissance égale, tandis qu’en 1950 1 % de croissance générait 0,06 € de VA, en 2013, il en générait 0,46 €. En 2013, comme une heure de travail génère en moyenne 7,8 fois plus de valeur qu’en 1950, la productivité horaire peut avoir un impact sur la création ou la destruction d’emplois.
Après avoir présenté les causes, les modes de calcul et l’évolution de la productivité horaire, je propose d’en étudier les conséquences.
-
Quelles sont les conséquences de la productivité horaire ?
En se combinant, le progrès technique et l’organisation du travail permettent de réduire le nombre d’heures de travail et de salariés affectés à une tâche. L’exemple de l’usine de production Alpha illustre les liens qui unissent le progrès technique et l’organisation du travail avec le nombre d’heures de travail et les effectifs d’une entreprise. En 1950, l’usine Alpha produisait 10 voitures (5 A et 5 B) avec 40 salariés et 100 heures de travail.
 En 2013, les dirigeants de l’usine Alpha ont investi dans l’outil de production (robots et machines numériques) et fait appel à des consultants en organisation pour restructurer l’entreprise.
En 2013, les dirigeants de l’usine Alpha ont investi dans l’outil de production (robots et machines numériques) et fait appel à des consultants en organisation pour restructurer l’entreprise.
 Suite aux investissements et à la restructuration, l’usine Alpha produisait 100 voitures (50 A et 50 B) avec 20 salariés et 50 heures de travail. Ayant besoin de 2 fois moins de temps et de salariés pour produire 10 fois plus de voitures, le progrès technique et l’organisation du travail lui ont permis de générer d’importants gains de productivité. Cet exemple fictif, qui montre que la hausse de la productivité contribue à la baisse des effectifs, est confirmé par les données statistiques de l’Insee. Les graphiques ci-dessous comparent le taux de croissance de la productivité horaire avec le taux de croissance des effectifs par branches de 1950 à 2012.
Suite aux investissements et à la restructuration, l’usine Alpha produisait 100 voitures (50 A et 50 B) avec 20 salariés et 50 heures de travail. Ayant besoin de 2 fois moins de temps et de salariés pour produire 10 fois plus de voitures, le progrès technique et l’organisation du travail lui ont permis de générer d’importants gains de productivité. Cet exemple fictif, qui montre que la hausse de la productivité contribue à la baisse des effectifs, est confirmé par les données statistiques de l’Insee. Les graphiques ci-dessous comparent le taux de croissance de la productivité horaire avec le taux de croissance des effectifs par branches de 1950 à 2012.
 – Source : Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Op.Cit.
– Source : Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Op.Cit.
– Source : Insee, 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche, comptes nationaux, Op.Cit.
– Source : Insee, 6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés, Op-Cit.
Ces graphiques font apparaître le lien qui unit le taux de croissances de la productivité horaire d’une branche d’activité avec l’évolution de ses effectifs. Plus le taux de croissance est élevé, plus les effectifs diminuent. En effet, de 1950 à 2012, tandis que la productivité horaire de l’agriculture passait de 0,6 € à 19,3 € de l’heure, soit un taux de croissance de 3 131 %, les effectifs de cette branche d’activité passaient de 5,4 millions à 760 000 personnes, soit une baisse de 86,2 %. Ces données statistiques montrent que l’effondrement des effectifs de la branche agricole est pour l’essentiel dû aux gains de productivité. Sur la même période, tandis que la productivité de l’industrie passait de 3,5 € à 54,3 €, soit une hausse de 1 469 %, les effectifs de cette branche passaient de 4,7 à 3 millions de personnes, soit une baisse de 35,8 %. Les destructions d’emploi de la branche industrielle sont dues, pour une part aux gains de productivité, et pour une autre part, aux délocalisations des activités à faible valeur ajoutée (textile, équipement électrique, etc…) dans des pays émergents (Chine, Bangladesh, Turquie, etc…) où le coût et le droit du travail ne sont pas aussi élevés et contraignants qu’en France. Ces délocalisations sont favorisées par la suppression des taxes douanières, les TIC et les moyens de transport modernes.
À l’inverse, plus le taux de croissance de la productivité est faible, plus la branche crée d’emplois. En effet, de 1950 à 2012, tandis que la productivité horaire des services marchands passait de 9,6 € à 51,8 €, soit une hausse de 471 %, les effectifs de cette branche passaient de 5,1 à 13,5 millions de personnes, soit une hausse de 164 %. En ce qui concerne les services non marchands (santé, éducation, services sociaux, etc…), tandis que la productivité passait de 17 € à 38,6 €, soit une hausse de 133 %, les effectifs passaient de 3 à 7,9 millions de personnes, soit une hausse de 161 %. Le faible taux de croissance de la productivité des services marchands et non marchands explique l’apparition du Lean management. Puisque les emplois d’infirmières, d’aides-soignantes, de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, de mécaniciens, d’éboueurs, d’agents de sécurité, d’assistante ménagère, etc… ne sont pas délocalisables, le Lean management vise à optimiser la productivité horaire de ces services pour réduire les effectifs et les rendre plus rentable.
Ayant montré les liens qui unissent le taux de croissance de la productivité horaire avec la hausse du chômage, il est possible de décrire sa corrélation avec le taux de croissance du PIB. Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre le taux de croissance du PIB et de la productivité horaire du travail avec l’évolution des effectifs des entreprises de 1950 à 2013.
 – Source : Insee, 6.215 Productivités horaires du travail par branche[53].
– Source : Insee, 6.215 Productivités horaires du travail par branche[53].
– Source : Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, comptes nationaux, Op.Cit.
– Source : Insee, 1.102 Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l’année précédente chaînés[54].
Ce graphique montre qu’il existe un lien entre le taux de croissance du PIB et de la productivité horaire avec la création ou la destruction d’emplois.
 Lorsque le taux de croissance du PIB est inférieur à celui de la productivité horaire, le surplus d’activité ne parvient pas à compenser les destructions d’emplois provoquées par les gains de productivité. Le surplus d’activité étant insuffisant, les effectifs des entreprises diminuent, ce qui se traduit par une hausse du chômage. De 1957 à 1959, tandis que l’écart entre le taux de croissance du PIB et celui de la productivité était de moins 1,5 %, les effectifs ont diminué de 156 000 salariés. De 1982 à 1985, tandis que l’écart était de moins 4,7 %, les effectifs ont diminué de 198 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,9 point. De 1991 à 1993, l’écart étant de moins 2,9 %, les effectifs ont diminué de 395 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,8 point. La dernière plus forte baisse d’effectifs est consécutive à la crise de 2008. De 2008 à 2009, l’écart étant de moins 3,3 %, les effectifs ont diminué de 309 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,6 point. Ces exemples montrent que le taux de chômage augmente lorsque le taux de croissance des gains de productivité est supérieur à celui du PIB.
Lorsque le taux de croissance du PIB est inférieur à celui de la productivité horaire, le surplus d’activité ne parvient pas à compenser les destructions d’emplois provoquées par les gains de productivité. Le surplus d’activité étant insuffisant, les effectifs des entreprises diminuent, ce qui se traduit par une hausse du chômage. De 1957 à 1959, tandis que l’écart entre le taux de croissance du PIB et celui de la productivité était de moins 1,5 %, les effectifs ont diminué de 156 000 salariés. De 1982 à 1985, tandis que l’écart était de moins 4,7 %, les effectifs ont diminué de 198 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,9 point. De 1991 à 1993, l’écart étant de moins 2,9 %, les effectifs ont diminué de 395 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,8 point. La dernière plus forte baisse d’effectifs est consécutive à la crise de 2008. De 2008 à 2009, l’écart étant de moins 3,3 %, les effectifs ont diminué de 309 000 salariés, soit une hausse du taux de chômage de 1,6 point. Ces exemples montrent que le taux de chômage augmente lorsque le taux de croissance des gains de productivité est supérieur à celui du PIB.
À l’inverse, lorsque le taux de croissance du PIB est supérieur à celui de la productivité horaire, les effectifs des entreprises augmentent, ce qui se traduit par une baisse du chômage. De 1949 à 1968, tandis que le taux de croissance du PIB progressait de 164 %, celui de la productivité horaire augmentait de 165 %. L’écart étant de 1 point en faveur de la productivité, le taux de chômage de 1968 était seulement de 2,5 %. Entre 1986 et 1991, comme l’écart était de 5,8 points, les effectifs ont augmenté de 1,1 million, ce qui s’est traduit par une baisse du taux de chômage de 0,2 point. De 1994 à 2002, l’écart étant de 1,9 point, les effectifs ont augmenté de 2,4 millions, soit une baisse du taux de chômage de 2,7 points. L’écart étant seulement de 1,9 point, ce n’est pas le taux de croissance du PIB, mais la réduction du temps de travail, autorisée par la loi sur les 35 heures, qui a favorisé la hausse des effectifs. De 2004 à 2008, l’écart étant de 3,2 points, les effectifs ont augmenté de 908 000 salariés, soit une baisse du taux de chômage de 1,3 point. Ces exemples montrent que le taux de chômage diminue lorsque le taux de croissance du PIB est supérieur à celui de la productivité horaire ou que la réduction du temps de travail absorbe les gains de productivité.
La hausse du chômage étant corrélée à la productivité horaire, pour créer des emplois, il est donc nécessaire de relancer la croissance du PIB ou de réduire le temps de travail. Afin d’appréhender ces mécanismes, je propose d’étudier les enjeux du partage des surplus d’heures de travail et de la valeur ajoutée générée par les gains de productivité.
Les enjeux du partage de la valeur ajoutée générée par les gains de productivité..
Pour comprendre les liens qui unissent la relance de la croissance du PIB ou la réduction du temps de travail avec la création d’emplois, il est nécessaire d’aborder le partage des surplus d’heures de travail et de la valeur ajoutée générée par les gains de productivité. Le schéma ci-dessous présente le partage de la valeur ajoutée générée par les gains de productivité.
 Pour comprendre ce schéma, je propose de reprendre l’exemple de l’usine Alpha. Tandis qu’en 1950, elle produisait 10 voitures avec 40 salariés et 100 heures de travail, en 2013, elle en produisait 100 avec 20 salariés et 50 heures. Ayant besoin de 2 fois moins de temps et de salariés pour en produire 10 fois plus, elle génère d’importants gains de productivité. En lui permettant de réduire ses coûts de production, ces gains lui permettent d’augmenter la valeur ajoutée. Ayant besoin de moins d’heures de travail, elle se retrouve avec un surplus d’heures. Même si l’entreprise a besoin de moins d’heures, elle doit quand même rémunérer celles dont elle n’a plus besoin. Puisqu’avoir un surplus d’heures de travail équivaut à avoir un surplus de charges salariales, pour les diminuer, la direction de l’usine a le choix entre deux solutions : réduire les effectifs ou réduire le temps de travail.
Pour comprendre ce schéma, je propose de reprendre l’exemple de l’usine Alpha. Tandis qu’en 1950, elle produisait 10 voitures avec 40 salariés et 100 heures de travail, en 2013, elle en produisait 100 avec 20 salariés et 50 heures. Ayant besoin de 2 fois moins de temps et de salariés pour en produire 10 fois plus, elle génère d’importants gains de productivité. En lui permettant de réduire ses coûts de production, ces gains lui permettent d’augmenter la valeur ajoutée. Ayant besoin de moins d’heures de travail, elle se retrouve avec un surplus d’heures. Même si l’entreprise a besoin de moins d’heures, elle doit quand même rémunérer celles dont elle n’a plus besoin. Puisqu’avoir un surplus d’heures de travail équivaut à avoir un surplus de charges salariales, pour les diminuer, la direction de l’usine a le choix entre deux solutions : réduire les effectifs ou réduire le temps de travail.
La direction de l’usine peut décider de réduire le temps de travail en répartissant les surplus d’heures de travail et de charges salariales entre tous les salariés. Comme les salariés travailleront moins, à taux horaire constant, ils gagneront moins. Afin de compenser cette perte de revenu, la direction peut utiliser de la valeur ajoutée générée par les gains de productivité pour augmenter les salaires ou, plutôt, le taux horaire du travail. Cette solution se traduit par une baisse des profits et des dividendes. Ne nécessitant pas un surplus d’activité pour créer des emplois, ce choix évite d’augmenter les rejets de CO2, le gaspillage de matières premières et l’épuisement des ressources naturelles. La réduction du temps de travail apparaît donc comme une solution envisageable pour créer des emplois sans aggraver les processus écologiques et climatiques.
La direction de l’usine peut décider de supprimer les surplus d’heures de travail et de charges salariales en réduisant les effectifs. En diminuant ses charges salariales, l’entreprise augmente sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée générée par les gains de productivité et les licenciements peuvent servir à une hausse des salaires, des impôts, des investissements ou à une baisse des prix. Ils peuvent également servir à une hausse des dividendes ou des placements financiers. Pour créer des emplois, la valeur ajoutée doit provoquer un surplus d’activité capable de soutenir un taux de croissance du PIB supérieur aux gains de productivité. En m’appuyant sur les données de l’Insee, je vais à présent montrer comment la redistribution de la valeur ajoutée peut provoquer la hausse du chômage ou la création d’emplois.
-
Partage en faveur des salariés ou des actionnaires.
La valeur ajoutée peut être redistribuée en faveur des salariés : une hausse des salaires, des cotisations patronales (retraite, assurance maladie, allocation familiale) ou des avantages sociaux (congés payés, RTT, etc…) ou des actionnaires (fonds de pension, banques et investisseurs privés) sous la forme de dividendes. Le graphique ci-dessous présente le partage de la valeur ajoutée en faveur des salariés ou des actionnaires de 1950 à 2013.
 – Source : Insee, 7.101 Compte des sociétés non financières (S11)[55].
– Source : Insee, 7.101 Compte des sociétés non financières (S11)[55].
De 1949 à 1982, en passant de 3,4 à 206 milliards €, la valeur ajoutée redistribuée aux salariés sous la forme d’une rémunération (salaires bruts et cotisations patronales) a été multipliée par 65,8. En passant de 0,3 à 11,7 milliards €, celle versée aux actionnaires sous la forme de dividendes a été multipliée par 45,4. Tandis que la part versée aux salariés passait de 68,3 % à 73,4 %, soit une hausse de 5,1 points, celle versée aux actionnaires passait de 6,2 % à 4,2 %, soit une baisse de 2 points. Les surplus d’activités générés par ces 69,2 points d’écart ont soutenu la croissance du PIB et créent des emplois. Jusqu’en 1981, le taux de chômage était inférieur à 6 %.
À partir du milieu des années 80, les actionnaires ont exigé un taux de rentabilité de 15 %. Pour obtenir ce rendement, les entreprises ont bloqué les salaires, réduit les effectifs, fermé des unités de production et délocalisé. De 1983 à 2013, en passant de 226 à 712 milliards €, la valeur ajoutée versée aux salariés était multipliée par 3,2. En passant de 14 à 160 milliards €, celle versée aux actionnaires était multipliée par 11,3. Tandis que la part versée aux salariés passait de 73,1 % à 66,3 %, soit une baisse de 5,8 points, celle versée aux actionnaires passait de 4,6 % à 14,9 %, soit une hausse de 10,3 points.
En 2008, avant la crise des SUBPRIMES, la part versée aux actionnaires était de 21,8 %, soit une hausse de 17,2 points par rapport à 1983, et celle versée aux salariés était de 63,6 %, soit une baisse de 9,5 points. En passant de 69,2 à 51,4 points, l’écart de la redistribution de 17,8 points en faveur des actionnaires a occasionné une perte de pouvoir d’achat des ménages.
La finalité d’une entreprise n’est pas de créer des emplois, mais de pérenniser son activité et de générer toujours plus de profits pour ses dirigeants et ses actionnaires. Les actionnaires étant pour l’essentiel des fonds de pension, des banques et des investisseurs privés, les dividendes qu’ils perçoivent sont à nouveau placés sur les marchés financiers. Étant donné que, les bénéfices générés par l’activité économique réelle : les gains de productivité, les fusions d’entreprises, les licenciements, les fermetures de site de production, les délocalisations, etc…, ne contribuent pas à augmenter la consommation, ils ne servent pas à relancer la croissance du PIB et, donc, à créer des emplois.
En provoquant la stagnation des salaires, la redistribution en faveur des actionnaires a provoqué une baisse du pouvoir d’achat des ménages, et, donc de la consommation. Comme elle ne parvient pas à compenser la hausse des gains de productivité, le ralentissement de la croissance du PIB contribue à la stagnation de la création d’emploi et, donc, à la hausse du taux de chômage, qui fluctue désormais autour de 9 %.
Les bénéfices peuvent également servir à l’investissement ou être placés sur les marchés financiers.
-
Partage en faveur de l’investissement ou des placements financiers.
La valeur ajoutée peut être, d’une part, investis dans la recherche et le développement (R&D), l’outil de production et la formation, et, d’autre part, placé sur les marchés financiers. Le graphique ci-dessous présente les investissements et les profits financiers des sociétés non financières.
 – Source : Insee, 7.101 Compte des sociétés non financières (S11), Op.Cit.
– Source : Insee, 7.101 Compte des sociétés non financières (S11), Op.Cit.
– Source : Insee, 4.101 Principaux ratios des comptes des sociétés non financières (S11) et des entreprises individuelles non financières (S14AA)[56].
De 1949 à 2013, tandis que la part des investissements passait de 29 % à 22,6 %, soit une baisse de 6,4 points, celle des revenus financiers (D42 revenus distribués des sociétés) versés aux sociétés non financières passait de 6,1 % à 19,5 %, soit une hausse de 13,4 points. De 1949 à 1982, comme la part des profits financiers fluctuait entre 4,6 % et 8,8 %, ils correspondaient à des opportunités de placement de la trésorerie. De 1983 à 2008, juste avant la crise des SUBPRIMES, cette part est passée de 8,2 % à 27 %. L’écart de 18,8 points montre que des entreprises, dont le cœur de métier n’est pas la finance, placent de plus en plus de capitaux sur les marchés financiers au détriment de l’investissement. La baisse des investissements au profit des placements financiers à des répercussions sur la création d’emplois.
Dans un système de marché concurrentiel, pour pérenniser son activité une entreprise doit être plus compétitive et innovante que ses concurrentes. La mission de la R&D est de générer des innovations et des brevets dont la finalité est de créer de nouveaux produits. En commercialisant un nouveau produit, l’entreprise s’octroie un monopole temporaire et un avantage compétitif qui lui permettent de conquérir des parts de marché en augmentant ses prix, sa marge bénéficiaire et donc, ses bénéfices. En prenant le risque de développer et de commercialiser l’iPhone, Appel a bénéficié d’un avantage compétitif qui lui a permis de les vendre avec une marge relativement élevée. Les profits générés par l’iPhone lui ont permis d’investir dans la R&D, de créer des emplois, d’augmenter les salaires et de distribuer des dividendes à ses actionnaires.
Puisque l’investissement favorise le développement d’une entreprise, pourquoi choisirait-elle les placements financiers ? Une innovation génère des bénéfices si elle se vend et permet de créer un nouveau marché. Si elle ne se vend pas, l’investissement représente un coût et donc, une perte pour l’entreprise. L’offre de biens et de services marchands étant saturée, le choix d’un investissement est une prise de décision de plus en plus risquée qui engage l’avenir d’une entreprise. Chaque année, 90 % des 20.000 nouveaux produits proposés aux consommateurs européens sont des échecs commerciaux[57]. Étant donné que seuls 10 % des innovations génèrent des bénéfices, malgré leurs coûts élevés, le retour sur investissement n’est jamais garanti. Le succès de l’iPhone masque l’échec de milliers d’innovations, telles que la Google Glass, dont la conception et la commercialisation ont nécessité d’importants investissements. Le taux d’échec d’une innovation étant élevé, un investissement apparaît donc plus risqué qu’un placement financier.
L’accroissement des placements financiers par des sociétés non financières menace la stabilité de l’économie réelle. Depuis le milieu des années 80, les actionnaires exigent un taux de rentabilité de 15 %. Si un placement de 100 € rapporte 15 € et qu’un investissement de 100 € rapporte 5 €, d’un point de vue purement financier, il apparaît plus rentable et « moins risqué » d’investir sur les marchés financiers. Afin d’obtenir des taux de rendement plus élevés, les directeurs financiers favorisent des placements sur des produits dérivés (CDO, titrisation, etc…) de plus en plus spéculatifs, virtuels et risqués. Lorsqu’un krach boursier se produit (1987, 2001, 2008, etc…), les bénéfices générés par les gains de productivité, les licenciements et le blocage des salariales sont absorbés par l’effondrement du cours des actions et des titres. Le krach de 2008 a englouti la trésorerie d’entreprises qui aurait pu être investie dans la recherche et l’outil de production. N’ayant plus de trésorerie, les entreprises n’innovent plus, ne développent plus de nouveaux produits et donc, ne sont plus compétitives. N’étant plus compétitives, elles perdent des parts de marchés, ce qui se traduit par une baisse de l’activité et des bénéfices. Pour compenser ses pertes et rétablir sa trésorerie, l’entreprise est obligée de licencier du personnel et de fermer des sites de production. Ce qui se traduit par une hausse du chômage. Puisque l’investissement est l’une des conditions de la création d’emplois, les entreprises qui placent leurs bénéfices sur les marchés financiers contribuent à la hausse du chômage.
Même si les gains de productivité apparaissent comme la principale cause de la hausse du chômage, se sont les dirigeants des entreprises ou les assemblées générales des actionnaires (AG), qui prennent la décision de réduire les effectifs ou le temps de travail. S’ils décident de réduire les effectifs, le choix du partage de la valeur ajoutée générée par la productivité, les licenciements et la baisse des charges salariales a également un impact sur la création d’emploi. En effet, s’ils décident de les redistribuer sous la forme d’une baisse des prix ou d’une hausse des impôts, des salaires ou des investissements, ils contribueront à générer un surplus d’activité qui permettra de créer des emplois. Par contre, si, par cupidité, ils décident d’augmenter les dividendes ou les placements sur les marchés financiers, ils risquent de provoquer une stagnation de l’activité économique et donc, de favoriser la hausse du chômage. La hausse du chômage n’est donc pas due aux gains de productivité, mais aux choix des dirigeants des entreprises ou des AG des actionnaires.
En favorisant l’investissement, les entreprises peuvent également contribuer à l’émergence de nouvelles branches d’activités et donc, à la création de nouveaux gisements d’emploi.
-
Favoriser l’émergence de nouvelles branches d’activités.
Le progrès technique et l’organisation du travail favorisent le déversement de la main-d’œuvre d’une branche d’activité vers une autre. Le graphique ci-dessous présente le déversement de la main-d’œuvre des secteurs primaires (agriculture) et secondaires (industrie et construction) vers le secteur tertiaire[58] (services marchands et non marchands) de 1950 à 2010.
 – Source : Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Op.Cit.
– Source : Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Op.Cit.
De 1950 à 2010, grâce aux déversements de la main-d’œuvre, les effectifs du secteur primaire sont passés de 28 % à 3 %, ceux du secteur secondaire de 29 % à 19 % et ceux du secteur tertiaire de 42 % à 78 %. En 2010, comme dans de nombreux pays industrialisés, les effectifs du secteur tertiaire de la France étaient les plus importants. Le déversement est un euphémisme qui désigne le processus de destruction/création des emplois. Ce processus est accéléré par la concurrence que se livrent entre elles les entreprises pour conquérir des parts de marché. Les emplois détruits par le progrès technique et l’organisation du travail ont permis de libérer la main-d’œuvre nécessaire au développement des services marchands et non marchands. Les emplois à faible valeur ajoutée détruits dans l’agriculture et l’industrie ont été déversés dans les secteurs d’activités à plus forte valeur ajoutée (commerce, réparation, restauration, logistique, santé, éducation, informatique, juridique, etc.). Exigeant de nouvelles compétences et un niveau de qualification plus élevé, ces nouveaux métiers n’ont pas permis à tous les salariés qui ont perdu leur emploi dans l’agriculture et l’industrie d’en retrouver.
Le progrès technique, l’organisation du travail, les restructurations, les délocalisations, les innovations, les TIC et Internet ne cessent de générer des gains de productivité, de transformer les métiers et d’accélérer le processus de destruction/création des emplois. En s’informatisant, les services comptable ont permis de remplacer des secrétaires comptables par un comptable qui fournit plus de travail en moins de temps. Les emplois peu qualifiés et à faible valeur ajoutée de secrétaires ont été, en partie, remplacés par des emplois très qualifiés et à haute valeur ajoutée d’ingénieurs en informatique qui développent des logiciels de comptabilité. À terme se sont les métiers de comptable et d’expert-comptable qui risquent d’être détruit par l’automatisation et des algorithmes. En permettant la vente à distance, l’automatisation des tâches et le payement en ligne, le e-commerce remplace des emplois de vendeurs, d’employés libre-service et de caissières par des préparateurs de commandes. Pouvant être créés à l’étranger, le développement et la gestion d’un site de e-commerce risquent également de provoquer la délocalisation d’emplois d’informaticiens et de développeurs dans des pays où le coût de la main-d’œuvre qualifiée est moins élevé qu’en France, tels que l’Inde.
L’université d’Oxford, le Massachusetts Institute of Technology ou l’Institut Bruegel envisagent l’automatisation de 50 % des métiers à l’horizon 2025-2035[59]. L’automatisation, qui comprend les robots, l’intelligence artificielle et les algorithmes, supprimera des métiers qualifiés et très qualifiés à faible et à haute valeur ajoutée. Les métiers qui nécessitent un niveau moyen de qualification (employé de banque, comptable, conducteur de train, chauffeur de camion, etc.) ne seront pas les seuls à être menacés. En effet, des métiers très qualifiés (experts comptables, traders, journalistes, médecins, avocats, etc…) seront également concernés par l’automatisation. Des traders sont progressivement remplacés par des algorithmes qui prennent des décisions à la nanoseconde. En réduisant le nombre d’heures de travail nécessaire pour traiter un dossier, l’automatisation va détruire de nombreux emplois d’avocats. Là où il fallait mobiliser un nombre important d’heures de travail pour analyser un dossier, rechercher de la documentation et les jurisprudences, avec l’aide de bandes de données et d’algorithmes, il ne faudra plus qu’une poignée d’avocats. Comme il faudra toujours plaider, le métier d’avocat ne disparaîtra pas, mais il en faudra moins. Étant donné que, pour le moment, les ordinateurs et les robots n’ont pas d’imaginations et d’émotions et donc de créativité, seuls les métiers innovants et créatifs, de chercheurs, de concepteurs d’algorithmes, d’artistes, d’acteurs de théâtre, d’artisan, de sportifs, etc…, ne disparaîtront pas.
Puisque les entreprises auront besoin de moins de temps de travail et donc, de salariés pour produire autant, voire plus de biens et de services, le progrès technique apparaît à la fois comme une menace pour l’emploi et l’opportunité d’une transformation sociale. Afin d’éviter qu’une part croissante de la population se retrouve sans emploi, sans utilité sociale et sans raison d’être, il apparaît nécessaire de favoriser l’émergence d’une nouvelle branche d’activités à caractère non économique dont le but serait le développement et l’émancipation de chaque individu. En proposant un nouveau sens à la vie, cette nouvelle branche permettrait d’éviter l’effondrement social que provoqueront le progrès technique, l’organisation du travail, l’automatisation et les délocalisations.
Cette étude met en évidence que pour en finir avec le chômage, les gouvernements de la France et des pays industrialisés ont le choix entre deux solutions : relancer la croissance du PIB ou réduire le temps de travail. Le choix entre l’une ou l’autre de ces solutions n’est pas un choix économique, mais un choix de société dont dépend la survie et l’avenir de l’humanité.
Jean-Christophe Giuliani
Cet article est extrait de l’ouvrage « En finir avec le chômage : un choix de société ! ». Ce livre permet d’appréhender les enjeux du choix entre la relance de la croissance du PIB ou de la réduction du temps de travail. Vous pouvez le commander sur le site des Éditions du Net sous un format ePub ou Papier.
Pour accéder aux pages suivantes :
– La croissance du PIB peut-elle supprimer le chômage ?
– La réduction du temps de travail peut-elle supprimer le chômage ?
[48] Keynes John Maynard, Essais de persuasion, Paris, Gallimard, 1933, page 173.
[49] Wikipédia, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, [En ligne] (consulté le 28 octobre 2018), https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce
[50] Le Lean management est une méthodologie d’organisation du travail qui vise, d’une part, à éliminer les pertes de temps et les tâches sans valeur ajoutée, ainsi qu’à simplifier les processus en vue d’augmenter la fluidité, la flexibilité et l’agilité de l’entreprise, et, d’autre part, à normaliser et à standardiser les processus afin de les rendre plus fiables, stables et prévisibles et de s’assurer de la reproductibilité « parfaite » du processus pour tendre vers le zéro défaut et la satisfaction des clients. Son but est d’améliorer la satisfaction des clients et la performance financière de l’entreprise pour répondre aux objectifs stratégiques définis par la Direction Générale.
[51] Wikipédia, Kaizen, [En ligne] (consulté le 28 octobre 2018), https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaizen. La méthode KAIZEN consiste à optimiser progressivement et au quotidien l’organisation du travail pour réduire les coûts et le temps de travail et améliorer la qualité de la production.
[52] Insee, 6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés / 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche, [En ligne] (consulté le 25 février 2017), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383648?sommaire=2383694
[53] Insee, 6.215 Productivités horaires du travail par branche, [En ligne] (consulté le 25 février 2017), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383648?sommaire=2383694
[54] Insee, 1.102 Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l’année précédente chaînés, [En ligne] (consulté le 25 février 2017), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383629?sommaire=2383694
[55 Insee, 7.101 Compte des sociétés non financières (S11), [En ligne] (consulté le 25 février 2017), https://www.insee.fr/fr/statistiques/3547415?sommaire=3547646
[56] Insee, 4.101 Principaux ratios des comptes des sociétés non financières (S11) et des entreprises individuelles non financières (S14AA), [En ligne] (consulté le 25 février 2017), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383656?sommaire=2383694
[57] Lipovetsky Gilles, Le bonheur paradoxal, Paris, Gallimard, 2006, page 95.
[58] « Le secteur primaire » correspond aux activités liées à l’extraction des ressources naturelles (agriculture, pêche, exploitation forestière et exploitation minière…). « Le secteur secondaire » correspond aux activités liées à la transformation des matières premières, qui sont issues du secteur primaire (l’industrie du bois, du textile, aéronautique, automobile, pharmaceutique, électronique, le raffinage, la construction, etc…). « Le secteur tertiaire » regroupe pour l’essentiel des services (conseil, banque, assurance, distribution, communication, informatique, médias, tourisme, immobiliers, services aux particuliers, santé, éducation, servies sociaux, etc…).
[59] Pierric Marissal (2015), L’automatisation ne détruit pas le travail mais l’emploi salarié, L’Humanité, [En ligne] (consulté le 16 novembre 2018), https://www.humanite.fr/lautomatisation-ne-detruit-pas-le-travail-mais-lemploi-salarie-568403
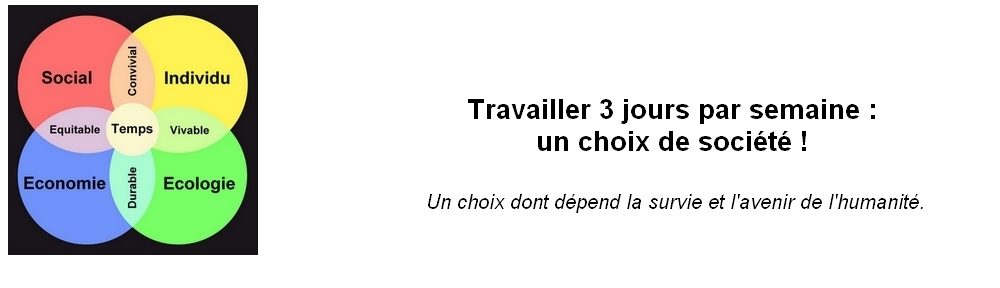

Le partage des gains de productivité et des bénéfices générés par ces gains sont responsable de la hausse ou de la baisse du chômage.