Jean-christophe Giuliani
 Depuis la loi Aubry sur les 35 heures, la réduction du temps de travail ne fait plus l’objet de débats. Que ce soit au PS ou à l’UMP, s’ils parlent de la durée du travail, c’est pour abroger les 35 heures ou l’augmenter. En ce qui concerne le MEDEF, il considère la réduction du temps de travail comme un frein à la compétitivité des entreprises françaises et donc, la cause du chômage. Le fait que les élites économiques et politiques évitent d’ouvrir ce débat est probablement dû au fait que la réduction de la durée légale du temps de travail n’est pas un choix économique, mais un choix de société. Afin de l’ouvrir à nouveau, je commencerai par expliquer pourquoi la réduction du temps de travail est un choix de société.
Depuis la loi Aubry sur les 35 heures, la réduction du temps de travail ne fait plus l’objet de débats. Que ce soit au PS ou à l’UMP, s’ils parlent de la durée du travail, c’est pour abroger les 35 heures ou l’augmenter. En ce qui concerne le MEDEF, il considère la réduction du temps de travail comme un frein à la compétitivité des entreprises françaises et donc, la cause du chômage. Le fait que les élites économiques et politiques évitent d’ouvrir ce débat est probablement dû au fait que la réduction de la durée légale du temps de travail n’est pas un choix économique, mais un choix de société. Afin de l’ouvrir à nouveau, je commencerai par expliquer pourquoi la réduction du temps de travail est un choix de société.
La légitimité de l’autorité d’une élite ne repose pas exclusivement sur l’emploi de la force et un système idéologique. Dans l’essai « Temps et ordre social », Roger Sue présente le temps comme un instrument d’organisation qui met en évidence les rapports de hiérarchie entre les différentes activités et catégories sociales. Même si le calendrier et l’horloge mesurent, quantifient et décomposent le temps en unités stables, homogènes et régulières, il est important de préciser que le temps abstrait de ces outils techniques ne relève pas de lois naturelles ou physiques observables, mais d’une construction sociale médiatisée et normalisée par un système idéologique qui peut être religieux, économique ou politique. Les séquences de temps et les concepts d’années, de mois et de semaines du calendrier sont donc des constructions abstraites et arbitraires. En effet, tandis qu’une semaine compte 7 jours en occident, elle pouvait compter 3,4 5 voire 6 en Afrique et 10 en Chine. En organisant le rythme des pratiques individuelles et collectives, ces outils techniques permettent « […] d’établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les individus, d’instaurer les communications utiles, d’interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l’apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc, pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. »[1] Permettant d’organiser, de réguler et de contrôler les relations entre les acteurs, le calendrier et l’horloge apparaissent donc comme des instruments de contrôle et de domination sociale.
La définition du temps social dominant et de la dynamique des temps sociaux.
Dans l’essai « Temps et ordre social », Roger Sue présente le temps comme un instrument d’organisation qui met en évidence les rapports de hiérarchie entre les différentes activités et catégories sociales. Comme toutes les sociétés se caractérisent par un certain agencement du temps, sa modification apparaît comme le signe d’une transformation sociale et donc, d’un changement de société. Cette mutation sociale intervient lorsqu’un temps social dominant est remplacé par un temps social émergeant qui, à son tour, devient dominant. L’étude des temps sociaux apparaît donc comme une grille de lecture pertinente de la dynamique des changements sociaux.
-
Quelles sont les caractéristiques du temps social dominant ?
Les temps sociaux[2] correspondent aux grands blocs de temps qu’une société se donne pour désigner, rythmer et coordonner les activités sociales auxquelles elle accorde une importance particulière. Étant de grande amplitude, ils permettent de déterminer les rythmes dominants et de distinguer les activités sociales dominantes d’une société donnée. Avec les temps sociaux, le temps n’apparaît plus comme un simple repère chronologique, mais comme le reflet de la dynamique sociale. Même si les temps sociaux donnent une approche réductrice et simplifiée de la réalité d’une organisation sociale, les activités qu’ils valorisent nous renseignent sur son système de valeurs et sa catégorie sociale dominante.
Roger Sue caractérise un temps social dominant[3] à partir de cinq critères. Le premier critère est quantitatif. Il consiste à calculer et à comparer la durée objective des différents temps sociaux. Un temps social est dominant lorsque la durée consacrée à une activité sociale est objectivement la plus importante. Au début du 19e siècle, comme l’ouvrier consacrait plus de 73 % de sa durée de vie éveillée à travailler, le temps social du travail était dominant. Le second correspond au mode de production[4] social dominant. Malgré la multiplicité des formes de productions sociales (production industrielle et marchande, production religieuse, production de la femme au foyer, du sportif et de l’acteur de théâtre, du bénévole, etc.), le mode de production considéré comme dominant est celui qui est pratiqué durant le temps social dominant. Même si la production marchande des pays industrialisés représente une infime partie de la production sociale, le temps social de l’économie est tellement dominant que la notion même de production se confond avec elle. Le troisième correspond à la valeur qualitative du temps social dominant. En effet, le temps social et le mode de production dominant déterminent et hiérarchisent les systèmes de valeur d’une société donnée. En valorisant une forme de production particulière, la société permet à l’individu de s’intégrer, de nourrir l’estime qu’il a de lui et de structurer son identité. Au début du 19e siècle, comme le temps social du travail était dominant, la valeur du travail était dominante.
Le quatrième correspond à la catégorie sociale dominante. Une société se caractérise par une catégorie sociale qui donne une image plus ou moins fidèle de son système hiérarchique. Sans le contrôle du temps, l’emploi de la force et d’une idéologie ne suffirait pas à légitimer l’autorité d’une élite. Provenant d’interactions et de conflits sociaux, le privilège de donner le temps est souvent lié aux pratiques sociales de la catégorie dominante. En contrôlant et en organisant le temps, la catégorie dominante impose son temps social, ses pratiques, son mode de production et son système de valeur aux autres catégories. La légitimité d’un système hiérarchique repose sur le contrôle de pratiques et de modes de production particulièrement valorisés par la société. Le rang ou le statut social d’un individu est donc déterminé par la place qu’il occupe dans le mode de production dominant. En imposant son temps social, la catégorie dominante influence les transformations politiques et sociales, ainsi que le sens de l’histoire. Étant donné que le pouvoir est détenu par celui qui contrôle le temps, la conquête du temps apparaît comme un enjeu de luttes politiques et sociales. Le temps social, le mode de production et les valeurs de l’économie étant actuellement dominants, la hiérarchie sociale est issue de la position occupée dans la division sociale du travail. Une catégorie sociale est considérée comme déclinante, lorsque son temps social, son mode de production et son système de valeurs ne conviennent plus pour décrire la réalité sociale émergeante. Il est donc nécessaire de rechercher dans les catégories sociales émergeantes, la nouvelle catégorie dominante et donc, le nouvel ordre social. Au 18e siècle, étant donné que le pouvoir temporel, le mode de production et les valeurs de l’Église déclinaient au profit de ceux de l’économie, l’ordre monarchique déclinait au profit de l’ordre bourgeois.
Le cinquième critère correspond au temps objectivement dominant d’un point de vue quantitatif, qui est reconnu comme tel par l’ensemble de la société. Il est important de distinguer le temps social dominant de la nouvelle catégorie sociale réellement dominante, du temps social déclinant de la catégorie sociale déclinante qui se croit encore dominante. En effet, pour préserver son autorité, une catégorie déclinante peut continuer à considérer son temps social comme dominant. Lorsque le temps social objectivement dominant de la catégorie émergeante s’accroît au détriment de la déclinante, la société est en crise. La crise se renforce lorsque la catégorie déclinante nie et minimise les valeurs et les modes de production de l’émergeante. Tant que les valeurs et les modes de production de la catégorie émergeante ne remplaceront pas ceux de la déclinante, la société sera en crise. Au début du 21e siècle, tandis que le temps social, le mode de production et la valeur du travail déclinent en faveur du temps libre, l’élite économique continue à considérer le travail comme la valeur dominante de la société. Après avoir défini le temps social dominant, il apparaît pertinent d’aborder la dynamique des temps sociaux.
-
Quelles sont les caractéristiques de la dynamique des temps sociaux ?
Il existe un lien étroit entre les temps sociaux dominants et la dynamique des temps sociaux. Roger Sue propose cinq grandes phases[5] qui correspondent au cycle entier d’un temps dominant : l’apogée, le déclin et le remplacement. À sa phase initiale, un temps social est dominant lorsqu’il est proche du monopole. Les autres temps sociaux sont quasiment inexistants et ne bénéficient d’aucune reconnaissance sociale. Au milieu du 19e siècle, comme les ouvriers consacraient plus de 73 % de leurs durées de vie éveillée à travailler, le temps social de travail était à son apogée. Lors de la seconde phase, de nouveaux temps sociaux émergent sous une forme mosaïque et résiduelle. Étant dépendants du temps dominant, ils ne disposent d’aucune autonomie. Au milieu du 19e siècle, même s’ils sont dépendants du temps du travail, ceux de l’éducation et de la famille commencent à émerger pour les membres de la classe ouvrière. Lors de la troisième phase, les temps sociaux émergeants commencent à prendre de l’ampleur. Étant compartimentés, ils ne constituent pas encore une alternative au temps social dominant. Même si le temps dominant amorce un déclin, ses modes de production et ses valeurs restent dominants. Des tensions ou des « pressions temporelles » apparaissent lorsque les modes de production, les valeurs et les catégories sociales liées aux temps sociaux émergeants entrent en compétition avec ceux des déclinants. Ayant l’impression de manquer de temps, de courir après le temps et qu’il « manque du temps au temps », le temps est de plus en plus vécu comme un problème. Le manque de temps apparaît donc comme le symptôme que les modes de production, les valeurs et les catégories émergeantes sont contraints de coexister et de partager leur temps avec les déclinantes.
La quatrième phase apparaît lorsque des temps sociaux émergeants s’agrègent entre eux pour former des blocs de temps dominants. Étant de plus en plus autonomes, ces blocs de temps sociaux influencent les modes de production et les catégories sociales déclinantes qui en sont dépendantes. Même si les catégories déclinantes ont encore l’illusion d’être dominantes, en réalité, se sont les catégories émergeantes qui sont désormais dominantes. Les temps sociaux dominants ayant changé, la société se transforme et change de temps. C’est un moment fragile de l’Histoire où quelque chose est en train de naître, mais qui n’est pas encore là. Ce « temps » où tout bascule est celui des « malaises temporels », de tensions et de crises de plus en plus aiguës. Si cette mutation, qui s’est déjà en partie produite dans le temps vécu, n’est pas reconnue par la catégorie déclinante, la société est en crise, « elle est malade du temps ». Ce n’est donc pas une crise économique, mais une crise du rapport à la temporalité que la France subit depuis la fin des années 60. Malgré l’émergence de nouveaux modes de production et systèmes de valeurs et d’une nouvelle catégorie dominantes, l’élite économique ne veut pas reconnaître le déclin de son autorité et donc, de l’ordre économique. Ne voulant pas accepter son déclin, elle entretient un climat de crise, qui est désormais systémique.
La cinquième et dernière phase apparaît lorsque le temps social objectivement dominant est « officiellement » reconnu comme tel. En se réconciliant avec son temps et donc, avec elle-même, la société sort de la crise. La société et l’ordre social se recomposent institutionnellement autour de nouveaux temps sociaux, de nouveaux modes de production, de nouvelles valeurs et de nouvelles catégories sociales. Le cycle historique étant bouclé, on en revient à la phase initiale.
Les transformations sociales intervenues lors des grands changements historiques peuvent s’expliquer à partir de la dynamique des temps sociaux. Les tensions, les conflits et les crises qui apparaissent lors de ces mutations sont les symptômes qu’une catégorie sociale déclinante ne souhaite pas laisser la place à l’émergeante qui est désormais dominante. Étant donné que de multiples facteurs (techniques, mœurs, idéologies, climatiques, etc.) peuvent expliquer ces changements sociaux, je n’affirmerai pas que la dynamique des temps sociaux les explique à eux seuls. Je tenterai simplement de mettre en évidence qu’un temps social dominant produit toujours un nouveau temps émergeant qui, à son tour, deviendra dominant. En produisant une rupture temporelle, ce nouveau temps social dominant provoquera un changement de société. Afin d’illustrer la dynamique des temps sociaux, j’aborderai l’apogée et le déclin de l’ordre religieux de la monarchie au profit de l’ordre économique de la bourgeoisie.
-
L’apogée et le déclin de l’ordre religieux au profit de l’ordre économique.
Le rapport au temps des sociétés primitives était structuré par le rythme des saisons (printemps, été, automne et hiver). Ce rythme étant cyclique, le temps social dominant était le temps circulaire. Étant donné qu’ils communiaient périodiquement avec les Dieux et les ancêtres, le mode de production dominant des sociétés primitives était de célébrer le retour aux origines. Les valeurs dominantes étaient donc celles qui respectaient les prescriptions des Dieux et des ancêtres. L’appartenance à la catégorie sociale dominante se transmettait à la naissance. Étant capables de rentrer en relation avec les Dieux et les ancêtres, les prêtres et les sorciers en faisaient également partie. En s’inscrivant dans le rythme cyclique des saisons et le retour aux origines, l’organisation sociale de ces sociétés était relativement stable. En remplaçant le temps circulaire par le temps linaire, le Judaïsme a rompu avec le rythme cyclique des sociétés primitives. Étant tourné vers l’avenir, le temps linéaire a inscrit le temps dans la durée. En l’inscrivant dans la durée, le Judaïsme a fait apparaître la question du sens de l’histoire. En s’inscrivant également dans la continuité du Judaïsme, la religion chrétienne adopta également le temps linéaire.
La première phase, qui correspond à l’apogée du règne de l’Église Chrétienne, commence au début du moyen âge. Le temps social dominant étant le temps religieux, les hommes naissaient, vivaient et mourraient dans un monde déiste. En apportant une réponse aux angoissantes questions du sens de la vie et de la mort, la doctrine de l’Église Chrétienne imposait son pouvoir spirituel. À l’apogée de son règne, elle imposait ses valeurs, son mode de production (l’économie du salut) et ses catégories sociales dominants. Le Roi étant le représentant de Dieu sur terre, les membres de l’église et de la monarchie appartenaient à la catégorie sociale dominante. La hiérarchie sociale était donc issue de la position occupée au sein de l’Église (Pape, cardinal, Évêque, Abbés, Prêtre) et de la monarchie (Roi, Duc, Comte, Baron, Marquis, Chevalier).
Étant donné que l’Église Chrétienne détenait le pouvoir temporel, elle avait la responsabilité de donner le temps. Les instruments de son pouvoir temporel étaient la datation de l’histoire, le calendrier et les cloches. En datant l’histoire à partir de la naissance du Christ, l’Église Chrétienne incarnait son pouvoir temporel dans le temps historique. Le rôle des cloches était de structurer le rythme de la société et des activités sociales au quotidien. En sonnant à heures fixes (laudes, prime, tierce, secte, none, vêpres et complies), les cloches donnaient les heures du levé, des prières, du travail, des repas et du coucher. En exerçant une surveillance quotidienne, les cloches rappelaient l’autorité et le pouvoir temporel de l’Église. Le calendrier, qui permettait de planifier les activités politiques et sociales, ainsi que les jours de fêtes religieuses chômées, était également un instrument d’organisation, de contrôle et de stabilité sociale. Au moyen âge, pour asseoir son autorité et manifester son pouvoir temporel, l’Église Chrétienne accordait entre 132 et 142 jours de fêtes chômées à la gloire de Dieu. Les grands propriétaires fonciers et les paysans s’élevaient contre le nombre important de jours chômés qui s’harmonisaient difficilement avec le rythme de la nature et donc, les récoltes. Le pouvoir temporel de Dieu et donc, de l’Église se manifestait concrètement à travers la datation de l’histoire, l’organisation du rythme de la société et les jours chômés.
La seconde phase apparaît au milieu du moyen âge avec l’émergence du temps social du travail. Même si le travail était un commandement biblique « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », il était considéré comme une malédiction. L’un des premiers devoirs du Roi étant d’assurer les subsistances à ses sujets, il avait besoin du travail des paysans et des marchands pour en assurer la production et la distribution. Étant utile au bien commun, le travail commença à bénéficier d’une certaine forme de considération de la part de l’Église. Les subsistances étant vitales, ceux qui souhaitaient s’enrichir avec son commerce risquaient l’excommunication, voire la peine de mort. Tant que le temps social du travail se contentait d’assurer les subsistances, son émergence ne menaçait pas l’autorité de l’Église et de la monarchie.
La troisième phase apparaît, entre le 11e et le 15e siècle. Les mouvements d’urbanisation du 11e et 13e siècle ont accéléré le processus de désacralisation du temps et la transformation sociale. Tandis que le rythme des villages était structuré par le temps religieux, celui des villes s’organisait progressivement autour du temps économique. Le développement des cités et de l’activité économique favorisa l’émergence d’une nouvelle classe : la bourgeoisie. Entre le 13e et le 14e siècle, le déclin du pouvoir temporel de l’église se manifesta avec l’apparition de l’horloge. En supplantant la cloche, l’horloge devenait le nouveau donneur de temps des villes. Étant visible, plus précise et régulière, l’horloge était mieux adaptée que la cloche pour réguler le rythme de la vie économique et sociale. En adoptant l’horloge, les villes commençaient à s’affranchir du pouvoir temporel de Dieu et donc, de l’Église. Le rythme des cités étant désormais dicté par l’horloge, le pouvoir temporel de l’Église déclinait au profit des artisans et des marchands.
Malgré le déclin de son pouvoir temporel, l’Église détenait toujours le pouvoir spirituel. En produisant des lois et des valeurs, sa doctrine proposait une conduite de vie qui permettait d’éviter des punitions (excommunication, enfer, etc.) et de recevoir des récompenses après la mort (paradis). En apportant une réponse à l’angoissante question de la vie après la mort, l’économie du salut permettait à l’Église de légitimer son autorité et d’exercer une influence sur les marchands et les banquiers. Ne détenant plus que le pouvoir spirituel, le pouvoir de l’église déclinait, entraînant la monarchie dans sa chute.
La quatrième phase apparaît entre le 16e et le 18e siècle. La renaissance annonça le déclin du temps religieux au profit du temps économique. En voulant retrouver la pureté religieuse, la réforme protestante engendra, malgré elle, un monde matérialiste totalement dominé par le travail et l’argent. En affirmant qu’en vertu d’un décret éternel, Dieu a attribué à chacun une destinée garantie dès la naissance, la prédestination a procuré un socle spirituel qui a profondément influencé la conduite et le sens de la vie des protestants. Selon ces décrets divins, tandis que l’élu sera sauvé et élevé à la gloire éternelle, le réprouvé sera damné pour l’éternité. Étant donné que Dieu ne dévoile pas ses décrets souverains, il était difficile de distinguer un élu d’un réprouvé. Les questions que se posaient les calvinistes étaient donc celles-ci : suis-je un élu ? Comment m’assurer de mon élection ? Selon Calvin, la divine providence a attribué à l’élu une vocation à laquelle il doit se consacrer tout entier. En exerçant sa vocation avec méthode et rationalité, l’élu améliorait sa condition et permettait à la communauté de prospérer. Le prestige social, les considérations et l’estime que lui apportait sa réussite professionnelle et financière étaient les signes de son élection divine. En transformant le travail et l’argent en moyen, but et finalité en soi, l’éthique protestante a remplacé « l’économie du salut » par « le salut par l’économie ». Ce renversement des valeurs provoqua le déclin du pouvoir spirituel que détenait encore l’Église Chrétienne.
En autorisant de prêter avec intérêt aux investisseurs et aux entrepreneurs, Calvin a profondément influencé les valeurs de la société et accéléré le déclin du pouvoir temporel de l’Église Chrétienne. Pouvant être mesuré par l’horloge et le calendrier, le temps pouvait être quantifié. Étant quantifiable comme une marchandise, il pouvait faire l’objet d’échanges et de spéculations. En transformant en argent le temps qui s’écoule entre la date de l’obtention d’un prêt et son remboursement, l’usure a transformé le temps en argent. Sous le pouvoir temporel de l’Église, le temps était par nature un bien public et inaliénable qui n’appartenait qu’à Dieu. En transformant le temps en argent, l’usure a fait de l’argent le nouveau Dieu de l’ordre économique naissant. En dépouillant le temps de ses attributs mystiques, la pratique de l’usure accéléra le déclin du pouvoir temporel de l’Église. Tandis que le pouvoir temporel de l’Église s’exprimait à travers la figure de Dieu, celui de l’économie s’exprimera à travers celle de l’argent. Étant donné que les marchands et les banquiers avaient le pouvoir de créer de l’argent à partir du temps, le pouvoir temporel de l’Église déclina au profit de celui de la bourgeoisie.
La Révolution des Lumières contribua également au déclin du pouvoir spirituel de l’Église. S’appuyant sur la recherche scientifique et des vérités objectives, les philosophes des Lumières remettaient en question les superstitions religieuses et donc, la croyance en Dieu. En faisant la promotion de la propriété, du travail, de l’usure, de la liberté du commerce des grains, les hommes des Lumières ont accéléré le déclin du pouvoir spirituel de l’Église au profit du pouvoir matériel de l’économie. Avec la liberté du commerce des grains, les physiocrates ont transformé le travail agricole et donc, les subsistances en moyen de s’enrichir.
En 1776, Adam Smith démontra que le travail permettait de créer la richesse, le développement économique et donc, le progrès social. Au même titre que l’usure, le travail transforme le temps en argent. En transformant les matières premières (coton, laine, etc.) en produits finis (robes, uniformes, etc.), le temps de travail produit des marchandises qui, lorsqu’elles sont vendues, se transforment en argent. En transformant le temps en argent, le travail contribua également à accélérer le déclin du pouvoir temporel de Dieu au profit de celui de l’argent.
En devenant le nouveau Dieu de la bourgeoisie, l’argent s’est transformé en étalon de la valeur de l’individu. En accumulant toujours plus d’argent, non seulement il prouvait son élection divine, mais en plus, il suscitait l’envie et l’admiration d’autrui. Étant donné qu’ils transforment le temps en argent, le travail et l’usure sont devenus les instruments du pouvoir et de l’autorité de la bourgeoisie. En s’agrégeant entre eux, le temps de l’horloge, du travail, du marchand, de l’usure et de la production se sont constitués en un bloc de temps homogène. Le changement de valeurs et de modes de production dominant provoqué par ce bloc de temps homogène accéléra l’effondrement du pouvoir temporel et spirituel de l’Église et de la monarchie au profit de la bourgeoisie.
Tandis que la noblesse tirait l’essentiel de ses profits de la propriété foncière, la bourgeoisie s’enrichissait avec le travail, la production, le commerce et l’usure. Étant d’essence divine, la légitimité de l’autorité de la monarchie reposait sur le pouvoir temporel et spirituel de l’Église. Ayant perdu le pouvoir temporel, spirituel et économique au profit de la bourgeoisie, la noblesse ne détenait plus que le pouvoir politique et certains privilèges. En effet, la monarchie détenait le pouvoir de voter les lois et de lever les impôts et les nobles avaient le droit d’accéder à des postes prestigieux dans l’administration et aux grades d’officier dans l’armée. Le levier du pouvoir étant désormais le Dieu argent, la lutte pour la conquête du pouvoir politique provoqua de multiples tensions, dont la conclusion fut la Révolution française.
La cinquième et dernière phase est apparue avec la Révolution française de 1789. En permettant au temps économique de l’ordre bourgeois de se substituer au temps religieux de l’ordre monarchique, la Révolution française a permis à la société de se réconcilier avec son temps. La production de « l’économie du salut » a été remplacée par la production du « salut par l’économie ». Sous l’ancien régime, quel que soit le montant de sa fortune, en fonction de sa naissance, un homme était noble ou roturier. Tous les hommes étant désormais libres et égaux en droit, ce n’était plus la naissance, mais la capacité à faire fructifier sa fortune qui devenait les nouveaux étalons de la valeur d’un individu. Le travail, l’argent et la propriété étant les valeurs dominantes, la légitimité de l’autorité d’un individu et sa place dans la hiérarchie sociale étaient déterminées par sa fortune et sa position occupée dans la division sociale du travail. En devenant la condition naturelle de l’existence de l’homme, le travail est devenu la religion des temps modernes. Étant toutes deux issues du travail, la classe bourgeoise et la classe ouvrière incarnaient les nouvelles catégories sociales de l’ordre économique.
Comme la bourgeoisie détenait le pouvoir temporel, spirituel, économique et politique, c’est à elle que revenait la responsabilité de voter les lois, d’organiser le rythme de la société et de maintenir l’ordre social. En prenant en main les institutions de l’État, la bourgeoisie organisa la société autour du travail. Afin d’établir son autorité, le parlement vota la « loi le Chapelier », supprima les corporations ainsi que les jours de fêtes religieuses qui étaient propices à l’oisiveté, aux désordres et aux émeutes. Non seulement, le travail dans les manufactures permettait de créer de la richesse, mais en plus, il était un moyen de contrôler et de surveiller la classe ouvrière, de légitimer les hiérarchies sociales et de maintenir l’ordre économique. Afin de renforcer son pouvoir temporel, elle abrogea également la loi sur la prohibition de l’usure qui autorisa le prêt avec intérêt[6].
Les travaux de Roger Sue mettent en évidence que le temps social dominant détermine les valeurs, le mode de production et la catégorie sociale dominante. La dynamique des temps sociaux fait également apparaître que l’émergence de nouveaux temps sociaux provoque le déclin des dominants au profit des émergents. En m’appuyant sur cette dynamique, il est donc possible d’appréhender les mutations sociétales actuelles et de tenter d’éclairer le passé et l’avenir.
Quelles sont les grandes étapes de la conquête du temps libre ?
Étant donné que la catégorie sociale qui contrôle le temps social dominant impose ses valeurs, son mode de production et son ordre social, le déclin du pouvoir temporel et spirituel de l’Église a provoqué le déclin de l’ordre religieux au profit de l’ordre économique. En m’appuyant sur la dynamique des temps sociaux de Rogers Sue, je tenterai à présent de montrer comment les réductions successives du temps de travail ont favorisé l’émergence de nouveaux temps sociaux et donc, les conditions d’une transformation sociale qui est actuellement en cours. Pour démontrer cette thèse, je me servirai de l’historique des lois sur la réduction de la durée légale du temps de travail. Ces lois me serviront de fils conducteurs à un récit historique et me permettront de calculer l’évolution du temps de travail d’un point de vue quantitatif.
 Le graphique ci-dessous présente la courbe de la réduction de la durée du temps de travail annuelle de 1831 à 2013.
Le graphique ci-dessous présente la courbe de la réduction de la durée du temps de travail annuelle de 1831 à 2013.

De 1831 à 2017, les lois sur la réduction du temps de travail ont permis de réduire sa durée légale de 3 041 à 1 515 heures par an, soit une diminution de 50,2%. En passant de 3 041 à 2 022 heures entre 1831 et 1936, la durée légale annuelle a diminué de 1 019 heures, soit une baisse de 33,5%. En passant de 2022 à 1515 heures entre 1936 à 2017, elle a diminué de 507 heures, soit une baisse de 25,1%. En m’appuyant sur la dynamique des temps sociaux, je vais tenter de montrer comment les réductions successives de la durée légale du temps de travail ont favorisé l’émergence de nouveaux temps sociaux.
-
L’apogée de la domination du temps social du travail.
L’apogée du travail, comme temps social, valeur et mode de production dominant, commence après la Révolution française et se termine en 1841. Au début du 19e siècle, la légitimité de l’autorité de la bourgeoisie reposait sur le temps social du travail. Afin de renforcer sa domination, elle a supprimé les jours de repos dominical et les fêtes chômées qui étaient considérés comme les vestiges de la superstition religieuse. En se substituant à la cloche de l’église, le sifflet de l’usine est devenu le nouveau donneur de temps de la société. Le rythme de la journée étant dicté l’usine, le rythme de la société était dicté par le rythme du travail. Étant soumis au rythme mécanique et quantitatif du travail, le temps perdait sa dimension spirituelle, au profit d’une dimension matérielle.
En 1841, qu’ils soient des femmes ou des enfants, les ouvriers travaillaient plus de 14 heures par jour, et cela 7 jours sur 7, soit 98 heures par semaine. Bénéficiant uniquement de 8 jours de fêtes chômées, ils travaillaient 4 984 heures par an. L’espérance de vie d’un ouvrier étant de 39 ans, il disposait en moyenne de 341 mille heures de vie. S’il commençait à travailler à partir de 6 ans, sa durée de vie active pouvait être de 33 ans. Comme il dormait 8 heures par jour, sa durée de vie active éveillée était de 192 mille heures. L’ouvrier consacrait donc 164 milles heures, soit 48 % de son espérance de vie et 85,3 % de sa durée de vie active éveillée à travailler. Le peu de temps libre qu’il avait à sa disposition servait juste à entretenir sa force de travail. En supprimant toute possibilité d’accès à d’autres temps sociaux, la bourgeoisie a fait du travail la condition naturelle et la religion de la classe ouvrière.
Les ouvriers percevaient un salaire qui leur permettait à peine d’assurer leurs substances. Comme le prix des subsistances était libre, le revenu ne permettait pas toujours de couvrir les hausses. Les causes de la stagnation des salaires et de la hausse de prix sont révélées par le révérend protestant J.Townsend. « L’obligation légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit ; la faim au contraire est non seulement une pression paisible, silencieuse et incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l’industrie elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Perpétuer la faim du travailleur, c’est donc le seul article important de son code de travail, mais pour l’exécuter, ajoute-t-il, il suffit de laisser faire le principe de population, actif surtout parmi les pauvres. »[7] Le but de la stagnation des salaires et de la hausse des prix est d’exercer une pression silencieuse sur les ouvriers. Étant contraints de travailler toujours plus pour assurer leurs subsistances, non seulement, ils n’avaient pas le temps de se socialiser autrement, mais en plus, ils renforçaient leur état de servitude volontaire à la bourgeoisie. Tandis que le sens de la vie de l’ouvrier se limitait à assurer sa survie, celui du bourgeois était de réussir sur le plan matériel pour se distinguer des autres, susciter l’admiration et l’envie, accroître son prestige et son pouvoir et prouver son élection divine.
Le temps de travail étant dominant, les valeurs et la morale issue du travail dominaient la société. Pour l’ouvrier, la valeur du travail s’incarnait dans la peine, l’effort, la discipline, l’ordre, la ponctualité et le respect de l’autorité. L’oisiveté étant la « mère de tous les vices », le travail évitait aux adultes désœuvrés de sombrer dans l’ivrognerie et aux enfants de faire des bêtises. Si l’oisiveté, le temps libre, l’instruction, les loisirs et la liberté étaient proscrits pour la classe ouvrière, ces valeurs ne l’étaient pas pour les rentiers, les propriétaires terriens, ainsi que pour les femmes et les enfants de la bourgeoisie. La bourgeoisie appliquait à la lettre la doctrine politique de Voltaire : « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » Les capacités de production n’étant pas suffisantes pour assurer la prospérité pour tous, l’oisiveté des uns dépendait de la misère et de l’exploitation des autres. Le temps libre consacré aux activités destinées à nourrir l’estime de soi et à l’accomplissement de la classe oisive était donc dépendant du temps de travail de la classe ouvrière.
-
L’émergence des temps sociaux de l’éducation, de la famille et des loisirs.
La seconde phase est apparue entre 1841 et 1914 avec l’émergence des temps sociaux de l’éducation, de la famille et des loisirs pour la classe ouvrière. Comme « le temps, c’est de l’argent », perdre du temps était synonyme de perdre de l’argent. Au milieu du 19e siècle, étant donné que la demande était plus importante que l’offre, la hausse des bénéfices reposait sur la hausse des ventes et donc, sur l’augmentation de la production. Pour augmenter sa production, l’entrepreneur avait le choix entre, augmenter ses effectifs, investir dans l’outil de production ou optimiser l’organisation du travail. Les ouvriers étant payés à l’heure ou à la pièce, augmenter les effectifs équivalait à augmenter les charges salariales. En prenant le risque d’investir dans les machines à vapeur et de nouvelles méthodes d’organisation du travail, les ingénieurs et les entrepreneurs ont augmenté la production sans augmenter les effectifs. Les gains de productivité générés par ces innovations ont permis de diminuer les coûts de production et donc, d’augmenter les bénéfices. De 1820 à 1850, la croissance du PIB ou de la productivité par actif a augmenté de 11 %[8]. Ces bénéfices, l’entrepreneur pouvait les redistribuer sous la forme d’une baisse des prix, ou d’une hausse des salaires, des investissements, des dividendes ou de sa rémunération. Ces redistributions permettaient de stimuler l’activité économique et donc, de créer à nouveau des emplois. La plupart des doctrines économiques du 19e siècle présentaient le progrès technique comme la condition de l’abondance, de la prospérité et du bien-être matériel pour tous. Pour Karl Marx, le partage équitable de la plus value était le seul moyen d’améliorer les conditions de vie des ouvriers et de réduire le temps de travail pour la nécessité au profit du travail libre. Étant considéré comme une atteinte à la liberté d’entreprendre, cet idéal n’était pas partagé par la bourgeoisie.
Étant donné qu’elle ne contribuait pas à augmenter la production, à stimuler l’activité économique et donc, à augmenter les bénéfices, la bourgeoisie a toujours été hostile à la réduction du temps de travail. Par conséquent, toutes les lois qui ont permis de réduire le temps de travail ont été conquises par des luttes sociales. Avant les premières lois sur la réduction de la durée légale du temps de travail, sa durée était limitée par la résistance physique de l’ouvrier. À cause du nombre et de l’intensité des heures de travail, l’espérance de vie moyenne des ouvriers était inférieure à 40 ans. Comme ils étaient moins résistants que les adultes, le taux de mortalité des enfants était très élevé. Ce taux étant élevé, le 22 mars 1841, les ouvriers se sont mobilisés pour obtenir une loi sur le travail des enfants. Cette loi permit d’interdire le travail des enfants de moins de 8 ans, de limiter à 8 heures par jour le temps de travail des enfants de 8 à 12 ans et de limiter à 12 heures celui des jeunes de 12 à 16 ans. Il faudra attendre la révolution de 1848 et le décret du 9 septembre pour que la journée de travail de tous les ouvriers soit limitée à 12 heures. Étant donné qu’ils travaillaient 7 jours par semaine, la durée légale hebdomadaire a donc été limitée à 84 heures.
En interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans, la loi du 19 mai 1874 permit l’émergence du temps social de l’éducation. En effet, le 28 mars 1882, en faisant voter la loi sur l’enseignement public obligatoire et gratuit pour tous les enfants de 6 à 12 ans, Jules Ferry permit aux enfants des couches populaires d’apprendre à lire, à écrire et à compter. Non seulement l’instruction obligatoire fournissait aux entreprises la main-d’œuvre qualifiée dont elle avait besoin pour se développer, mais en plus, elle inculquait à la jeunesse les valeurs du travail, de l’effort, de la discipline, de l’ordre, de la ponctualité et du respect de l’autorité. La gratuité de l’instruction obligatoire a permis aux enfants de la classe ouvrière d’accéder au temps social de l’éducation qui était jusqu’alors réservée à ceux de la petite et grande bourgeoisie.
Que ce soit en France et aux États-Unis, les revendications pour la journée de 8 heures : « 8 h de travail, 8 h de sommeil et 8 h de loisir », furent l’objet de manifestations et de répressions violentes. À Chicago, la répression policière de la manifestation du 1er mai 1886 a provoqué la mort de trois personnes. À Fourmis, dans le Nord de la France, la répression de la manifestation du 1er mai 1891 se solda par la mort de dix personnes. L’origine de la fête du 1er mai étant des manifestations pour la journée de 8 heures, au lieu de l’appeler la « fête du Travail », en la mémoire des victimes, il apparaît plus judicieux de l’appeler la « fête pour la réduction du temps de travail ».
Le 30 septembre 1900, la loi Millerand permit de limiter la durée légale de la journée de travail à 10 heures. Il faudra attendre la crise politique et sociale provoquée par la catastrophe minière de Courrières du 10 mars 1906 pour que la loi du 13 juillet donne enfin aux ouvriers une journée de repos hebdomadaire obligatoire. La journée de 10 heures et le jour de repos ont permis de réduire la durée légale du travail hebdomadaire à 60 heures.
De 1841 à 1906, la durée légale du temps de travail est passée de 98 à 60 heures par semaine. Tandis que de 1850 à 1910, le PIB par actif progressait de 62,8 %[9], le temps de travail diminué de 38,8 %. En 1906, étant donné que la durée légale de la journée de travail était de 10 h et que les ouvriers bénéficiaient d’une journée de repos hebdomadaire et de 8 jours de fêtes chômées, la durée légale d’une année de travail était de 3 040 heures. L’espérance de vie d’un ouvrier étant de 48 ans[10], il disposait en moyenne de 420 mille heures de vie. Ayant le droit de commencer à travailler à partir de 12 ans, sa durée de vie active pouvait être de 36 ans. Comme il dormait 8 heures par jour, sa durée de vie active éveillée était de 210 mille heures. Quelques années avant la Première Guerre mondiale, l’ouvrier consacrait donc 109 milles heures, soit 26 % de son espérance de vie et 52 % de sa durée de vie active éveillée à travailler.
La journée de repos hebdomadaire a permis l’émergence du temps libre individuel que l’ouvrier pouvait consacrer à se reposer, à sa vie de famille ou à des loisirs personnels. Permettant de se socialiser et de nourrir l’estime de soi autrement que par le travail, ces pratiques favorisèrent l’émergence de nouveaux modes de vie. Même si elle commençait à accéder aux temps sociaux de l’éducation, de la famille et des loisirs, la classe ouvrière ne menaçait pas l’autorité de l’élite économique. Au contraire, en disposant d’une main-d’œuvre moins fatiguée, mieux formée et plus disciplinée, les entreprises augmentaient leur productivité et donc, leurs bénéfices.
-
La conquête du temps libre individuel.
La troisième phase est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. La victoire militaire dépendait de la capacité, d’une part, à produire rapidement une grande quantité d’obus, de fusils, de canons, d’avions et de navires de guerre, etc., et, d’autre part, à assurer la subsistance des troupes et de la population civile. Les hommes étant mobilisés sur le front, l’industrie de guerre, l’industrie civile et l’agriculture manquaient de mains-d’œuvre pour assurer la production. Le progrès technique des outils de production et les nouvelles méthodes d’organisation du travail ont permis de compenser ce manque de main-d’œuvre. Ne nécessitant pas d’une main-d’œuvre qualifiée, le taylorisme, la parcellisation des tâches et le travail à la chaîne ont permis à des femmes et à des ouvriers non qualifiés de remplacer les ouvriers qualifiés mobilisés sur le front. Après la guerre, les technologies et les méthodes de production issues de l’industrie militaire ont été transférées à l’industrie civile. Ces transferts technologiques ont permis de construire une infrastructure de production moderne capable d’assurer l’abondance, la prospérité et le bien-être matériel pour tous. Afin de récompenser le sacrifice des Français durant la guerre et surtout, d’éviter une révolution sociale qui aurait pu éclater le 1er mai, le 23 avril 1919, le gouvernement de George Clemenceau fit enfin voter la loi sur la journée de 8 heures. En partageant une partie de la prospérité générée par le progrès technique, cette loi permit à la classe ouvrière de consacrer un peu de temps libre au temps social de la famille, à des loisirs ou à des activités personnelles après la journée de travail.
Le progrès technique et les méthodes de production issues de la guerre ont permis d’augmenter considérablement les gains de productivité et donc, les capacités de production des entreprises. En accélérant le rythme de la production, ces gains ont provoqué la hausse des stocks de marchandises. Étant donné qu’un stock qui ne se vend pas représente un coût et donc, une perte, la hausse des bénéfices et la survie des entreprises dépendaient désormais de l’augmentation de la consommation. En effet, ce n’est pas le travail, mais la vente du bien produit par le travail qui transforme le temps en argent. Les bénéfices étant générés par les ventes, l’accélération du rythme de la production nécessitait l’accélération du rythme de la consommation. La consommation ostentatoire, qui était jusqu’alors réservée à la bourgeoisie, n’était plus suffisante pour écouler les stocks. Afin d’augmenter leurs ventes, les industrielles américaines ont fait appel à des agences de marketing. Leur mission était de motiver la classe moyenne, qui jusqu’alors menait un mode de vie frugale, à nourrir l’estime de soi et à se procurer des plaisirs par l’intermédiaire de la consommation ostentatoire. Cette révolution culturelle, qui débuta aux États-Unis au début des années 20, permit l’émergence de la société de consommation de masse.
Le temps social du travail et la société de consommation ont été sérieusement menacés par la crise de 1929. Pour faire face à l’augmentation du chômage technologique consécutive à la hausse des gains de productivité et à la crise des marchés financiers, le gouvernement américain avait le choix entre la réduction de la durée légale du temps de travail ou la relance de la demande par une politique de grands travaux. Le 6 avril 1933, soutenu par les syndicats et la classe ouvrière, le sénat des États-Unis a voté la loi Black-Connery dont le but était de réduire la durée légale du temps de travail à 30 heures par semaine. « Le rapport de l’AFL sur la réduction du temps de travail ne parlait ni de chômage, ni de salaires plus élevés, mais s’attardait plutôt à un long éloge des loisirs du travailleur, les décrivant nécessaires au bon développement du corps, de l’esprit et de l’âme […] à la richesse de la vie […] un progrès social […] à la civilisation elle-même »[11]. La finalité de cette loi n’était pas uniquement de lutter contre la hausse du chômage. En permettant enfin à la classe ouvrière et à la classe moyenne d’accéder au temps libre, qui était jusqu’alors réservé à la classe privilégiée, son but était, d’une part, de permettre aux salariés de développer leurs corps et leurs esprits, et, d’autre part, de favoriser le progrès social et l’évolution de la civilisation. La loi Black enthousiasma le peuple américain, mais fit frissonner Wall Street. Non seulement cette loi menaçait leurs profits, mais en plus, elle aurait empêché l’émergence de la société de consommation et l’hégémonie économique des États-Unis. En remettant en question la centralité du travail, cette loi aurait également accéléré le déclin du pouvoir temporel du travail et donc, le déclin de l’autorité de l’élite économique. Après avoir été votée par le Sénat, la loi Black devait être entérinée par le Congrès. Soutenu par les milieux d’affaires et les industriels, le président Roosevelt abrogea la loi Black au profit de la nouvelle politique nationale, plus connue sous le nom de New Deal.
Au début des années 30, pour sortir de la crise, l’économiste John Maynard Keynes et le philosophe Bertrand Russel proposaient des solutions qui remettaient en question la domination du temps social du travail. Dans le chapitre intitulé « Perspective économique pour nos petits enfants », Keynes préconisait de lutter contre la hausse du chômage technologique en réduisant la durée légale du temps de travail à 15 heures par semaine[12]. Sa préoccupation n’était pas la valeur du travail, mais l’usage du temps libre. Ayant été aliéné toute sa vie par le travail, comment l’individu moyen utilisera-t-il son temps libre ? Pour Bertrand Russel, le travail était à la fois une vertu et la cause de tous les maux du monde moderne. Dans l’essai « Éloge de l’oisiveté », il proposait d’utiliser le progrès technique pour réduire la durée légale du temps de travail à 4 heures par jour[13]. Pour lui, seule l’augmentation du temps libre permettrait le progrès social et l’évolution de la civilisation. Même si ces propositions allaient dans le sens de l’histoire, la loi Black a été rejetée par le Congrès et les propositions de Keynes et de Bertrand Russel n’ont pas fait l’objet d’applications concrètes.
Malgré l’abondance de la production et des gains de productivité, le patronat était hostile à la réduction du temps de travail et au partage des bénéfices issus de ces gains. Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir du Front populaire et les grèves de 1936 pour que les lois du 11 et 12 juin permettent aux ouvriers français d’arracher au patronat une seconde journée de repos hebdomadaire et 2 semaines de congés payés.
À partir de 1936, le luxe du temps libre individuel et des vacances n’était plus réservé à une caste de privilégiés. En élargissant la perception de l’existence et en donnant un nouveau sens à la vie, ces lois ont provoqué le déclin du temps social du travail au profit de l’émergence du temps libre individuel. Ayant le temps de pratiquer de nouvelles activités (artistique, sportive, jardinage, etc.), les membres de la classe ouvrière avaient désormais les moyens de se socialiser et de nourrir l’estime de soi autrement que par l’activité professionnelle. Même si l’identité et le statut de l’individu étaient encore déterminés par sa place dans l’ordre du travail, cette rupture provoqua un changement de mode de vie individuel et une révolution silencieuse du temps.
De 1906 à 1936, la durée légale du temps de travail est passée de 60 à 40 heures par semaine. Tandis que de 1920 à 1940 le PIB par actif progressait de 43,9 %[14], le temps de travail diminuait de 33,3 %. À la fin de 1936, étant donné que la durée légale de la journée de travail était de 8 h et qu’un salarié bénéficiait de 2 jours de repos hebdomadaire, de 2 semaines de congés payés et de 10 jours de fête chômés, la durée légale de son année de travail était de 1 920 heures. L’espérance de vie d’un ouvrier étant de 58 ans[15], il disposait en moyenne de 508 mille heures de vie. Ayant le droit de commencer à travailler à partir de 12 ans, sa durée de vie active pouvait être de 46 ans. Comme il dormait 8 heures par jour, sa durée de vie active éveillée était de 268 mille heures. Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, l’ouvrier consacrait donc 88 milles heures, soit 17,4 % de son espérance de vie et 33 % de sa durée de vie active éveillée à travailler.
Les réductions successives du temps de travail ont provoqué le déclin du temps social du travail au profit des temps sociaux de l’éducation, de la famille, des loisirs et du temps libre individuel. Même si le temps social du travail déclinait, sa valeur était toujours dominante. En effet, étant donné que le salarié travaillait 5 jours par semaine son statut, son identité et sa place dans la société étaient toujours attachés à son appartenance à un collectif de travail. Il en était donc toujours dépendant pour se socialiser, nourrir l’estime de soi et donner un sens à sa vie.
En associant le temps social du travail à celle de la consommation, l’élite économique détenait un nouveau moyen de renforcer la légitimité de son autorité.
La révolution silencieuse du rapport à la temporalité.
La quatrième phase, qui est toujours d’actualité aujourd’hui, est apparue en France après la Seconde Guerre mondiale. La guerre terminée, les transferts de technologies issues de l’industrie militaire vers l’industrie civile ont permis de générer d’importants gains de productivité. Pour les milieux d’affaires, les opportunités de profits issus de la Première Guerre semblaient ridicules par rapport à ceux qui seraient issus de la Seconde. Sauf que les conditions politiques de la fin de la Seconde Guerre n’étaient plus celles de la Première ! Non seulement le monde est entré dans une guerre froide qui opposait le capitalisme au communisme, mais en plus, le parti communiste était majoritaire aux élections. De surcroît, en mars 1944, le Conseil National de la Résistance (CNR) a rédigé un programme destiné à être appliqué après la libération.
Ce programme comprenait, entre autres, des mesures qui concernaient les traîtres à la nation et la mise en œuvre d’une politique économique et sociale favorable aux intérêts de la classe ouvrière. De nombreux témoignages, rapports de police et documents prouvaient que des industrielles et des banquiers avaient collaboré activement avec l’occupant et le régime de Vichy[16]. Les collaborateurs avaient peur d’être fusillés, d’être jetés en prison, de se faire confisquer leurs biens, leurs entreprises et les bénéfices réalisés durant la guerre. Les nationalisations des usines Renault et Gnome et Rhône, dont les dirigeants avaient ouvertement collaboré avec le régime nazi, ont effrayé les milieux d’affaires qui n’avaient pas la conscience tranquille. Ne souhaitant pas faire l’objet d’enquêtes approfondies sur leur agissement avant et pendant l’occupation, ils n’ont pas osé s’opposer trop ouvertement à la mise en œuvre du programme du CNR.
Après la libération, d’août 1944 à octobre 1946, les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir ont mis en œuvre une politique économique et sociale qui s’inspirait du programme du CNR. Pour favoriser la reconstruction et le redressement économique de la France, ils ont, entre autres, nationalisé les banques de dépôt, les houillères du Nord, les compagnies de gaz et d’électricités et le transport aérien. Afin de contrôler les prix et d’éviter l’inflation, le gouvernement provisoire de Charles de Gaule a signé l’Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Sur le plan social, ils ont, entre autres, créé un système de sécurité sociale qui comprenait l’assurance maladie, les allocations familiales et la retraite. Le 21 février 1946, ils ont rétabli les 2 journées de repos hebdomadaire et la journée de 8 heures qui avaient été supprimées par le régime de Vichy. Pour favoriser l’ascension sociale des jeunes issus des milieux populaires, ils ont créé l’enseignement public gratuit pour tous. De 1945 à 1968, la mise en œuvre du programme du CNR a permis la constitution de blocs de temps économiques et sociaux homogènes qui ont favorisé la prospérité de la France et une révolution silencieuse du rapport à la temporalité.
-
La constitution de blocs de temps économiques et sociaux homogènes.
En favorisant le partage équitable de la valeur ajoutée, la mise en œuvre du programme du CNR a permis la constitution de blocs de temps économiques et sociaux homogènes.
Le premier bloc de temps sociaux est celui de la vie active. La vie active correspond à la période durant laquelle l’individu exerce une activité professionnelle. Cette période correspond à un bloc de temps homogène qui comprend de nombreux temps sociaux, tels que le temps social du travail, de la famille, des loisirs, de la consommation, de la formation et du temps libre individuel.
En 1968, étant donné que la durée légale de la journée de travail était de 8 h et qu’un salarié bénéficiait de 2 jours de repos hebdomadaire, de 3 semaines de congés payés et de 11 jours de fête chômés, la durée légale de son année de travail était de 1 864 heures. Comme la durée de vie active était de 40 ans et que l’ouvrier dormait en moyenne 8 heures par jour, sa durée de vie active éveillée était de 233 mille heures. L’ouvrier consacrait donc 74 milles heures, soit 31,9 % de sa durée de vie active éveillée à travailler. L’espérance de vie étant de 67,8 ans[17], comme il disposait de 593 mille heures de vie, il consacrait seulement 12,6 % de sa durée de vie moyenne à travailler.
Malgré son effondrement sur la durée de l’espérance de vie, ces calculs mettent en évidence que le temps social du travail est toujours dominant sur les 40 années de vie active éveillée. Même si les temps sociaux de la famille, de l’éducation, de la retraite et du temps libre individuel forment un bloc de temps sociaux homogènes sur la durée de l’espérance de vie, le temps social du travail est toujours dominant. Étant toujours dominant sur la durée de vie active éveillée, le rythme de la vie des salariés et de la société s’organise autour de l’emploi du temps professionnel. En effet, c’est après sa journée de travail, que le salarié dispose de quelques heures de temps libre pour effectuer ses tâches quotidiennes et domestiques, se consacrer à ses enfants et à sa famille, regarder la télévision, se divertir, se former ou pratiquer des activités personnelles. Le temps social et la valeur du travail étant toujours dominant, il est dépendant de son activité professionnelle pour se socialiser et nourrir l’estime qu’il a de lui. Non seulement son existence sociale, son statut et son identité sont déterminés par son appartenance à une communauté professionnelle, mais en plus, sa place dans la hiérarchie sociale est toujours définie par sa position occupée dans la catégorie sociale du travail. Le temps social et la valeur du travail étant toujours dominants sur la durée de vie active éveillée, l’élite économique se considère toujours comme la catégorie sociale dominante.
De 1949 à 1968, la productivité horaire du travail et la valeur ajoutée en volume sont respectivement passées de 5,4 à 14,3 € de l’heure[18] et de 244 à 625 milliards €[19], soit des taux de progression de 165 % et de 156 %. En passant de 1 912 à 1 864 heures, la durée légale de l’année de travail a seulement été diminuée de 2,5 %. La seule réduction du temps de travail que les salariés ont pu obtenir est la semaine de congés payés conquis en mars 1956. La valeur ajoutée a, entre autres, servis à rémunérer les détenteurs du capital, à financer les investissements, l’assurance maladie, les retraites, les allocations familiales et à augmenter la rémunération des salariés. En effet, sur la même période, la part de la valeur ajoutée en valeur consacrée à la rémunération des salariés est passée de 49,2 % à 55,1 %[20]. En ce qui concerne les gains de productivité, ils n’ont pas contribué à réduire le temps de travail, mais à augmenter l’offre marchande. Tandis que les gains de productivité ont élargi l’offre marchande, la valeur ajoutée a augmenté le pouvoir d’achat des ménages. La combinaison des deux a favorisé l’émergence de la société de consommation.
Le second bloc de temps social est celui de la consommation. Les transferts de technologie issus de l’industrie militaire vers l’industrie civile ont considérablement accéléré le rythme de la production. Pour écouler les stocks, l’accélération du rythme de la production nécessitait l’accélération du rythme de la consommation. La société de consommation de masse, qui était apparue aux États-Unis au début des années 20, émergea donc en France au début des années 50.
TCOTS 1 Machines à bonheur 1/3, Edward Bernays… par fermetabush
En élargissant l’offre de biens et de services marchands, la société de consommation a révolutionné le mode de vie de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Les retombées de cette révolution culturelle étaient multiples : écouler les stocks, élargir l’offre marchande, générer des profits, créer des emplois, réfréner les revendications portant sur la réduction du temps de travail, justifier l’utilité et la valeur du travail, légitimer l’autorité de l’élite économique et gagner la guerre idéologique. En effet, pour gagner la guerre froide, le système capitaliste devait montrer qu’il était plus apte à apporter le bien-être matériel et le bonheur que le système communiste.
En favorisant l’accès au lave-linge, au frigidaire, à la gazinière, à l’eau courante, à la salle de bain, à la télévision, au téléphone, à la voiture, etc., qui étaient jusqu’alors réservés aux classes aisées, la société de consommation a permis aux membres de la classe ouvrière et de la classe moyenne de gagner du temps et d’accéder à un réel confort matériel. Lorsque le minimum de confort matériel a été atteint, la consommation est devenue ostentatoire (meubles de cuisine, mode vestimentaire, marques de voitures, etc.). N’ayant plus la vocation de répondre à des besoins réels, la consommation c’est transformé en moyen d’exprimer son appartenance sociale, d’affirmer sa réussite et de se distinguer de la classe ouvrière. En devenant un moyen de se socialiser et de nourrir l’estime de soi, la consommation ostentatoire a profondément transformé le mode de vie des ouvriers, des cadres et des classes moyennes.
En incitant les ménages à consommer au-delà de leurs moyens, le crédit à la consommation a donné un nouveau souffle à l’usure. Au lieu de prendre le temps d’économiser, les ménages étaient encouragés par la publicité à contracter un emprunt auprès de sociétés de crédit. En souscrivant un crédit à la consommation, l’individu s’engage à rembourser le prêt, plus les intérêts dont le taux est relativement élevé (entre 20 % et 30 %). En se transformant en intérêt, le temps, qui s’écoule entre la date de la souscription et du remboursement de l’emprunt, se transforme en argent. Le crédit à la consommation apparaît également comme un moyen d’exercer une pression paisible, silencieuse et incessante sur le salarié. En effet, pour rembourser son emprunt avec les intérêts, il est plus ou moins contraint de travailler toujours plus. Au même titre que l’activité professionnelle et la consommation, le crédit à la consommation apparaît donc comme un moyen de contrôle social. Étant donné que c’est l’argent et le crédit qui permettent l’acte d’achat, la société de consommation a renforcé l’emprise du pouvoir temporel de l’argent sur les individus et la société.
La consommation ne concerne pas que les biens marchands. En exploitant la réduction du temps de travail et les congés payés, l’industrie du divertissement, qui comprend l’industrie culturelle (musique, cinéma, télévision, presse, etc.), l’industrie des loisirs marchands (parc d’attractions, manifestations sportives, boites de nuit, etc.) et l’industrie du tourisme, a élargi l’offre de consommation à de nouveaux marchés. Ces industries ont permis de créer des emplois et de générer des profits en divertissant ou plutôt, en occupant le temps libre. Tant que l’individu occupe son temps libre à se divertir, il ne le consacre pas à la politique ou à former son esprit critique. Ces divertissements évitent également qu’il consacre trop de temps à pratiquer une activité amateur qui lui permettrait de se socialiser, de nourrir l’estime de soi et de s’épanouir autrement que par l’activité professionnelle et la consommation.
La société de consommation a également évité le déclin du temps social du travail. Au lieu d’être utilisées pour réduire le temps de travail, la hausse des gains de productivité et de la valeur ajoutée ont servi à élargir l’offre marchand et à augmenter le pouvoir d’achat des ménages. Les luttes sociales pour le partage de la valeur ajoutée ont davantage bénéficié à l’augmentation du pouvoir d’achat qu’à la réduction de la durée légale du temps de travail. En effet, pour avoir le droit d’accéder à la consommation ostentatoire, au tourisme, à la culture et aux loisirs marchands, les salariés revendiquaient une augmentation des salaires. De 1949 à 1968, tandis que la part de la valeur ajoutée consacrée à la rémunération des salariés progressait de 14,9 points[21], la consommation des ménages passait de 8 à 53,4 milliards €[22]. En abandonnant la revendication portant sur la réduction de la durée légale du temps de travail au profit de celle qui portait sur la hausse du pouvoir d’achat, les salariés ont revendiqué le droit de s’aliéner au travail et de compenser leurs vies gâchées à travailler par la consommation.
Non seulement la société de consommation a permis au temps social du travail de rester dominant, mais en plus, elle a renforcé l’emprise du pouvoir temporel de l’argent. En s’agrégeant entre eux, le temps social du travail, de la consommation et du crédit à la consommation forment une unité homogène qui donne à l’élite économique les moyens de légitimer son autorité.
Le troisième bloc de temps sociaux est celui de la retraite. La retraite, qui consiste à percevoir un revenu sécurisé et stable sans être obligé de travailler, correspond à un idéal auquel aspirent les salariés. À la différence du Paradis des religions monothéistes, cet idéal est atteignable. En effet, pour avoir le droit à la retraite, le salarié devait travailler pendant 40 ans. Ses besoins essentiels satisfaits et sécurisés, le retraité peut enfin accéder au temps libre qui était autrefois réservé aux aristocrates et aux rentiers. Le rythme de sa vie n’étant plus structuré par celui du travail, c’est désormais à lui que revient la responsabilité de donner un sens à son temps et donc, à sa vie. En fonction de ses envies ou de ses aspirations, il peut se socialiser, nourrir l’estime qu’il a de lui et s’accomplir en consacrant du temps à sa famille, à ses petits-enfants, à des activités associatives bénévoles ou à des activités personnelles librement choisies.
La retraite, qui est souvent présentée comme une conquête sociale majeure, est en réalité la compensation d’une vie gâchée à travailler. En 1946, l’espérance de vie moyenne des hommes était de 60 ans[23]. Étant donné que l’âge légal du départ à la retraite était fixé à 65 ans[24], rares étaient ceux qui avaient le droit et la chance d’y accéder. Épuisés et brisés par des années de travail, très peu avaient l’occasion d’en profiter. Les mineurs, qui avaient travaillé au fond d’une fosse, finissaient souvent avec la silicose. Les quelques années qui leur restaient à vivre étaient bien souvent des années de souffrance et de lente agonie.
Étant souvent présentée comme un moment de repos bien mérité, de liberté retrouvée et de rêves à concrétiser, la retraite apparaît comme un objectif désirable à atteindre. Encore faut-il que le retraité ait pris le temps de la préparer et de faire un travail préalable sur lui-même à la fin de sa vie active. S’il n’a pas pris le temps de la préparer, la confrontation à la retraite peut très vite devenir une source d’ennuis, de désœuvrement, d’anxiété, d’angoisse et donc, une expérience traumatisante. Étant donné que durant sa vie active, l’entreprise était souvent son principal lieu de socialisation, du jour au lendemain le retraité se retrouve isolé, coupé du rapport aux autres et à la société. Ayant perdu ce qui donnait un sens à sa vie, c’est-à-dire l’activité professionnelle qui lui procurait des gratifications sociales et une identité, qui lui imposait un cadre et des contraintes horaires et qui le motivait à se lever le matin, il se retrouve totalement désœuvré. La retraite peut donc très vite conduire à la dépression et au suicide. Une étude de 2002 montre que 15 à 30 % des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent de dépression[25]. Selon une étude du CepiDc-Inserm, 28 % des 10 400 suicides survenus en France en 2010 concernaient des personnes âgées de plus de 65 ans.
La retraite ne servait pas uniquement les intérêts des salariés. En effet, pour se développer, les entreprises avaient besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et formée aux nouvelles méthodes de production. La tertiarisation de l’économie nécessitait une main-d’œuvre plus qualifiée et formée aux métiers du tertiaire. Le coût de la reconversion étant élevé, le départ à la retraite permettait de se débarrasser à moindres frais des salariés âgés qui étaient épuisés et brisés par le travail. En partant à la retraite, ils laissaient la place à des salariés mieux formés aux nouvelles méthodes de production et aux métiers du tertiaire.
La dynamique des temps sociaux permet également d’apporter un autre regard sur la retraite. Même si elle a permis de réduire la part du temps consacré au travail sur l’espérance de vie, elle n’a pas contribué à la réduire sur les 40 années de vie active. Les revendications pour le droit à la retraite ont permis de réfréner celles qui auraient pu porter sur la réduction du temps de travail. Dès 1945, au lieu de financer la retraite, les gains de productivité et la valeur ajoutée auraient pu servir à réduire le temps de travail. L’espérance de vie moyenne des hommes étant de 60 ans, il aurait été plus judicieux de commencer par réduire le temps de travail que de fixer l’âge du départ à la retraite à 65 ans. En écartant les revendications portants sur la réduction de la durée légale du temps de travail, celle pour la retraite ont évité l’effondrement du temps social du travail et donc, le déclin de l’ordre économique.
Le quatrième bloc de temps sociaux est celui de l’éducation. Le préambule de la constitution de 1946 comprenait ce texte : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » Afin de favoriser l’égalité des chances et l’ascension sociale de la classe ouvrière et de la classe moyenne, la mise en œuvre du programme du CNR a donné le droit à tous les enfants, aux jeunes et aux adultes d’accéder gratuitement à l’enseignement public et à la formation professionnelle.
L’allongement de la durée des études a été favorisé par les besoins de l’industrie et l’émergence des métiers du tertiaire. Après la guerre, la compétitivité et la capacité d’innovation des entreprises étaient étroitement liées au niveau de formation de la main-d’œuvre. L’évolution des outils et des méthodes de production, ainsi que l’émergence du secteur tertiaire nécessitaient une main-d’œuvre plus qualifiée. Le développement économique étant de plus en plus dépendant du niveau de formation de la jeunesse, une part de la valeur ajoutée a été investie dans le système éducatif.
L’éducation nationale n’avait pas uniquement la mission d’apprendre aux jeunes à lire, à écrire, à compter et à acquérir des connaissances. Son rôle était, entre autres, de leur apprendre la discipline, la ponctualité, l’effort, le respect et l’obéissance à la hiérarchie. Sa mission était également de leur transmettre la valeur du travail, de les former aux besoins des entreprises et de favoriser leurs intégrations au monde du travail. Que ce soit à la maternelle, au collège et au lycée, le rythme de la journée était dicté par une cloche ou une sirène. En se réveillant à 7 h du matin, en effectuant un trajet aller et retour pour se rendre à l’école, en étant attentif au cours du matin et de l’après-midi et en prenant une pause à midi, le jeune s’habitue progressivement à intégrer le rythme du travail. Le rythme de la vie scolaire étant calqué sur celui de l’entreprise, en allant à l’école l’enfant intériorise le rythme du temps social du travail.
En 1930, la grande majorité des 78 mille étudiants qui suivaient des études universitaires provenaient de la petite et grande bourgeoisie, ainsi que de familles d’enseignants. Afin de favoriser l’égalité des chances et l’ascension sociale de la classe ouvrière et de la classe moyenne, le programme du CNR a également donné aux jeunes adultes le droit d’accéder à des études universitaires gratuites. De 1950 à 1968, le nombre d’étudiants est passé de 137 à 600 milles.
L’accès aux études universitaires contribua à révolutionner la conception et le sens de la vie des jeunes issus du baby boum. En suivant des études en sociologie, en histoire, en lettre et en philosophie, l’étudiant élargissait sa perception du monde, de la société et de lui-même. En préparant des études universitaires, l’étudiant retardait son entrée dans la vie professionnelle, dite active. Les universités étant concentrées dans quelques grandes villes de France (Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, etc.), s’il habitait à la campagne ou dans une petite ville de province, pour poursuivre des études universitaires, il devait quitter le foyer familial. Il est important de préciser que le jeune ne quittait pas sa famille pour se marier et fonder un foyer, mais pour ses études. En s’installant dans une chambre d’étudiant ou un campus, il découvrait une forme de liberté et un mode de vie que ne pouvait pas connaître celui qui quitter sa famille uniquement pour fonder un foyer. N’ayant pas de famille à charge, l’étudiant pouvait consacrer son temps à ses études et à expérimenter de nouvelles formes de socialisation et d’expression librement choisie. Les heures de cours étant moins nombreuses qu’au lycée, il disposait d’une plus grande autonomie pour gérer son emploi du temps. En expérimentant de nouvelles pratiques de vie, non seulement, l’étudiant changeait sa manière de concevoir la vie et sa propre existence, mais en plus, il découvrait qu’il était possible de se socialiser, de nourrir l’estime de soi et de s’accomplir autrement que par l’activité professionnelle et la consommation. Sans s’en rendre compte, il découvrait qu’une vie plus épanouissante était possible en dehors de l’entreprise !
-
La crise du rapport à la temporalité
À la fin des années 60, les étudiants issus du baby boum avaient entre 18 et 23 ans. Non seulement ils n’avaient pas connu la guerre, la faim, le monde du travail et le chômage, mais en plus, ils avaient vécu les conséquences positives et négatives de l’ascension sociale de leurs parents. Ayant élargi leur perception de la vie, connu le temps libre pour soi et pratiqué de nouvelles formes de socialisation et d’expressions plus épanouissantes, les jeunes diplômés issus de l’université et des grandes écoles devenaient plus exigeants vis-à-vis de l’intérêt et du sens de leur travail. En prenant conscience que la consommation ostentatoire de leurs parents était une compensation d’une vie gâchée à travailler, l’entrée dans la vie active n’apparaissait pas comme une perspective réjouissante. Ayant connu l’autonomie et la liberté, les jeunes étudiants issus de la classe ouvrière et de la classe moyenne n’étaient pas prêts à accepter l’état de servitude volontaire de leurs parents.
Cet état d’esprit vis-à-vis du travail ne concernait pas que les jeunes et les étudiants. En 1968, une part croissante d’ouvriers qualifiés, de techniciens, d’ingénieurs et de cadres avaient sécurisé leurs besoins essentiels, assuré leur confort matériel et stabilisé leur situation sociale. Le chômage étant quasiment inexistant, ils n’avaient pas peur de perdre leur emploi. Ayant une stabilité professionnelle et la possibilité de construire leurs carrières au sein de la même entreprise, ils pouvaient se projeter dans l’avenir et donner un sens personnel à leurs vies. Malgré ces conditions « idylliques », les travaux de recherche de Jean Rousselet faisaient apparaître qu’ils vivaient une révolution silencieuse du temps qui affectait profondément leurs relations au travail. « Les jeunes ne sont pas seuls à témoigner d’une telle désaffection pour l’activité de travail. Beaucoup d’adultes, de travailleurs déjà insérés dans la vie active ressentent ou affichent le même mépris des tâches et des responsabilités qui sont exigées d’eux. Chez certains, cet état d’esprit ne fait que prolonger un état d’esprit développé pendant la jeunesse. L’expérience vient le renforcer en permettant de vérifier sur le terrain le pessimisme des jugements préalables et surtout en dévalorisant tout ce qui avait pu contribuer à embellir la perspective de la future existence professionnelle d’attraits étrangers à son aspect purement travail. »[25] […]« Il n’est pas sans intérêt d’apprendre ainsi que si pour 98 % des jeunes l’activité laborieuse a aujourd’hui complètement perdu son sens de devoir ou d’obligation morale, il en va de même pour 95 % des adultes. Pour cette écrasante majorité, elle n’est plus et dans un ordre décroissant, qu’un moyen de gagner sa vie, un échange de temps contre de l’argent, une contrainte sociale et pour quelques-uns même le seul moyen de lutter contre l’ennuie. »[26]
À mesure que leur pouvoir d’achat s’élevait, plus de 90 % des salariés adoptaient une posture critique vis-à-vis du travail et de la consommation. Auparavant considérée comme un devoir moral et le pôle de référence de la construction identitaire, l’activité professionnelle était désormais perçue comme une contrainte sociale et un simple moyen de gagner sa vie. Mais surtout, les salariés prenaient conscience que pour gagner plus ou plutôt, perdre leurs vies à consommer, ils étaient contraints d’échanger du temps contre de l’argent. Les besoins essentiels, d’appartenance et d’estime ayant été satisfaite, le besoin de réalisation de soi émergeait. Ayant eu une expérience significative du travail, les salariés avaient eu le temps de constater que l’activité professionnelle n’avait pas la vocation de répondre à leurs aspirations. Nombreux étaient ceux qui aspiraient à plus de temps libre pour choisir librement leur vie et leur mode de vie. S’exprimant sous la forme de tensions de plus en plus aiguës, cette période de mutation individuelle et sociale apparaît comme un moment de fragilité dans la trajectoire de l’individu et de la société. Le roman ou le film « l’arrangement »[27] d’Elia Kazan décrit cette quête de soi et de sens, qui apparaît comme un moment de rupture, de fragilité et de crise existentielle profonde. Étant donné que les mutations individuelles et sociales qui se produisaient déjà dans les faits, c’est-à-dire dans le temps vécu, n’étaient pas reconnues et acceptées par l’élite économique et le discours politique et médiatique dominant, la société est entrée dans une crise du rapport à la temporalité. « La société était en crise, elle était malade du temps ».
En mai 1968, que ce soit en France, en Italie, au Japon, aux États-Unis, etc., de nombreux pays industrialisés étaient confrontés à un état de crise et de révolte. Le gouvernement et le patronat devaient faire face à deux formes de revendications très différentes : la « critique sociale » et la « critique artiste »[28]. La critique sociale était portée par les ouvriers, les syndicats et le parti communiste. Leurs revendications concernaient le partage de la valeur ajoutée, ce qui se traduisait dans les faits par une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail.
Ce n’était pas la critique sociale, mais la critique artiste qui préoccupait le plus le patronat et l’élite économique. Ces revendications les inquiétaient d’autant plus, qu’elles étaient portées par des étudiants, des jeunes diplômés récemment sortis des universités et des grandes écoles, ainsi que par des ouvriers qualifiés, des techniciens, des cadres et des ingénieurs et donc, par les membres de la classe moyenne ascendantes. Les tenants de la critique artiste dénonçaient l’oppression du système capitaliste, le désenchantement du monde, la perte de sens du monde bourgeois, ainsi que la déshumanisation et l’aliénation du monde du travail. Ils dénonçaient également l’inauthenticité de l’existence, la nécessité d’avoir un emploi pour s’insérer socialement et la misère de la vie quotidienne « métro, boulot, dodo ». Ceux qui avaient une expérience du travail dénonçaient les tâches prescrites et répétitives, la séparation de la conception de l’exécution, les horaires imposés et l’absence de créativité et d’autonomie dans les entreprises. Ils rejetaient le processus de subordination hiérarchique et l’autoritarisme des entreprises. Ce n’est pas un hasard, si l’un des slogans de mai 68 était « ne perdait pas votre vie à la gagner. » Aspirant à plus d’autonomie, de liberté et de créativité, les tenants de la critique artiste souhaitaient disposer de plus de temps libre.
De 1850 à 1940, tandis que la croissance du PIB par actif avait progressé de 140 %, la durée légale du temps de travail annuel avait diminué de 61,5 %[29]. En comparaison, de 1949 à 1968, tandis que la productivité horaire du travail avait progressé de 165 %[30], elle diminuait seulement de 2,2 %. La génération des années 60 était celle des petits-enfants de Keynes. Au milieu des années 30, il avait préconisé qu’ils travailleraient 15 heures par semaine[31]. En 1968, étant donné qu’ils travaillaient 8 heures par jour et qu’ils disposaient de 2 journées de repos, la durée de travail légale hebdomadaire était toujours de 40 heures.
Tandis que la durée légale était de 40 heures, la durée moyenne était passée de 47 à 45 heures. L’écart étant compris entre 7 et 5 heures, les trente glorieuses étaient une période de plein emploi. En effet, en 1968, le taux de chômage concernait uniquement 2,5 % de la population active[32]. Ce n’était donc pas la lutte contre le chômage, mais l’amélioration de la qualité de vie qui préoccupait les salariés. La qualité de vie étant étroitement liée au temps libre, les salariés les mieux instruits, formés et qualifiés revendiquaient la réduction de la durée légale du temps de travail, quitte à gagner moins. Même s’ils ne le formulaient pas ainsi, ils souhaitaient se socialiser, nourrir l’estime de soi et s’accomplir autrement que par l’activité professionnelle et la consommation.
Face aux revendications des cadres et de la classe moyenne, le gouvernement et le patronat avaient le choix entre deux solutions : réduire progressivement la durée légale du temps de travail ou provoquer un climat involontaire ou volontaire de crise. Le choix entre l’une ou l’autre de ces solutions n’apparaît pas comme un choix économique, mais comme un choix de société.
-
Les conséquences du choix de la réduction du temps de travail.
Afin de répondre aux revendications des cadres et des classes moyennes, le gouvernement et le patronat auraient pu envisager de réduire progressivement la durée légale du temps de travail en fonction de l’évolution de sa durée moyenne. Cette solution, qui allait dans le sens de l’histoire, aurait, d’une part, évité la crise et la hausse du chômage, et, d’autre part, ouvert de nouvelles perspectives de vie, donné un nouvel élan à la société et provoqué une mutation sociale. En m’appuyant sur la dynamique des temps sociaux de Roger Sue, je vais à présent tenter d’expliquer les conséquences économiques, politiques et sociales de ce choix.
De 1968 à 1973, comme la productivité horaire avait progressé de 36,5 %, l’écart entre la durée moyenne et légale du temps de travail était passé de 5 à 2 heures. Afin d’éviter la hausse du chômage, la durée légale du temps de travail aurait dû être réduite à 35 heures dès 1973. De 1974 à 1981, la productivité horaire ayant progressé de 20,5 %, l’écart était passé de 2 à -1 heure. Pour éviter la hausse du chômage, le nombre de journées légales de repos hebdomadaire aurait dû passer à 3 jours en 1981. De 1982 à 1997, étant donné qu’elle avait progressé de 39,5 %, l’écart était passé de 1 à -3 heures. Pour enrayer la hausse du chômage, le nombre de journées de repos aurait dû passer à 4 jours en 1998. Si le gouvernement et le patronat avaient suivi cette règle, non seulement, il n’y aurait pas eu de chômage, mais en plus, la part de la durée de vie active éveillée consacrée au travail aurait été de 27,4 %, de 24,8 % et de 18,2 %. En inversant le rapport à la temporalité (temps de travail < temps libre individuel), la réduction progressive de la semaine de travail de 5 à 3 jours aurait provoqué le déclin, puis l’effondrement du temps social du travail au profit de celui du temps libre individuel.
L’effondrement du temps social du travail aurait provoqué le déclin des modes de production liés au travail : la production de l’industrie, des marchands et de la finance, au profit de modes de production liés au temps libre individuel. Le mode de production du travail n’étant plus dominant, l’entreprise aurait retrouvé sa fonction initiale : être un simple moyen de production de biens et de services destinés à satisfaire des besoins essentiels. Le temps libre individuel étant le temps social dominant, le rythme de la société se serait réorganisé autour de la production de la famille, de l’éducation, de la formation, de la politique, de la recherche, du bénévolat et des activités associatives amateurs.
L’effondrement du temps social du travail aurait provoqué le déclin de sa valeur. Le temps libre dont dispose un individu détermine les moyens qu’il utilise pour se socialiser et nourrir l’estime de soi. Comme le fait remarquer André Gorz, en inversant le rapport à la temporalité, l’augmentation du nombre de jours de repos hebdomadaire aurait favorisé de nouvelles pratiques quotidiennes et donc, de nouveaux modes de vie. « À mesure, en effet, que s’étendent les plages de temps disponibles, le temps de non-travail peut cesser d’être l’opposé du temps de travail : il peut cesser d’être un temps de repos, de détente, de récupération ; temps d’activités accessoires, complémentaires de la vie de travail ; paresse, qui n’est que l’envers de l’astreinte au travail forcé, hétérodéterminé ; divertissement qui est l’envers du travail anesthésiant et épuisant par sa monotonie. À mesure que s’étend le temps disponible, la possibilité et le besoin se développent de le structurer par d’autres activités et d’autres rapports dans lesquels les individus développent leurs facultés autrement, acquièrent d’autres capacités, conduisent une autre vie. Le lieu de travail et l’emploi peuvent alors cesser d’être les seuls espaces de socialisation et les seules sources d’identité sociales ; le domaine du hors-travail peut cesser d’être le domaine du privé et de la consommation. De nouveaux rapports de coopération peuvent être tissés dans le temps disponible et ouvrir un nouvel espace sociétal et culturel, fait d’activités autonomes, aux fins librement choisies. Un nouveau rapport, inversé, entre temps de travail et temps disponible temps alors à s’établir : les activités autonomes peuvent devenir prépondérantes par rapport à la vie de travail, la sphère de la liberté par rapport à celle de la nécessité. Le temps de la vie n’a plus à être géré en fonction du temps de travail ; c’est le travail qui doit trouver sa place, subordonnée, dans un projet de vie. »[33] En permettant à chaque individu de disposer de 3 puis de 4 journées par semaine, le temps libre aurait cessé d’être un temps de repos, de détente et de récupération. Au lieu de le gaspiller à regarder la télévision ou à pratiquer des activités de divertissement et de loisirs marchands, l’individu aurait ressenti le besoin de se prendre en charge en planifiant de nouvelles activités de socialisation et d’expression. En pratiquant de nouvelles activités, il aurait enrichi sa personnalité. En enrichissant sa personnalité, il aurait attiré l’attention, l’admiration, le respect et l’estime d’autrui pour ce qu’il « est » réellement. N’ayant plus besoin de l’activité professionnelle pour se définir et nourrir l’estime qu’il a de lui, le travail n’aurait plus été le support de son statut et de son identité. À partir du moment où il aurait commencé à concevoir autrement sa propre existence, son identité et son mode de vie, la valeur du travail se serait effondrée. N’étant plus une valeur dominante, le travail serait redevenu l’instrument qu’il aurait toujours dû être : un simple moyen de production.
L’effondrement du temps social du travail aurait également provoqué celui du pouvoir temporel de l’argent. Pour que l’argent soit l’étalon de la valeur d’un individu, la réussite financière et matérielle doit susciter l’estime d’autrui. En travaillant moins, l’individu aurait gagné moins et donc, consommé moins. En revanche, il aurait disposé de plus de temps libre qui lui aurait donné les moyens de multiplier ses activités de socialisation et d’expression. En pratiquant une activité artistique, intellectuelle, manuelle ou sportive amateur, il aurait eu les moyens de nourrir son estime, de s’accomplir et d’enrichir sa personnalité. En enrichissant sa personnalité, il aurait davantage attiré l’estime et l’attention d’autrui pour ce qu’il « est » que pour ce qu’il « a ». Étant davantage reconnu pour ce qu’il « est », il aurait pu se passer de la réussite financière et matérielle pour s’aimer et être aimé. Comme l’avait déjà fait remarquer John Maynard Keynes, le déclin du pouvoir temporel de l’argent aurait provoqué de profondes mutations sociales. « Il faut nous attendre aussi à des modifications d’un autre ordre : lorsque au point de vue social, l’accumulation des richesses ne jouera plus le même rôle, l’on verra se modifier sensiblement le code de la morale. Nous pourrons nous débarrasser de nombreux principes pseudo-moraux qui nous hantent depuis deux cents ans, et qui ont contribué à faire passer pour les plus hautes vertus certains des penchants humains les plus méprisables. Le mobile de l’argent sera estimé à sa juste valeur. On verra dans l’amour de l’argent – non pour les joies et les distractions qu’il vous procure, mais pour lui-même – un penchant plutôt morbide, une de ces inclinations plus ou moins criminelles, plus ou moins pathologiques, que l’on remet, non sans un frisson, entre les mains du psychiatre. Nous serons alors libres de rejeter toutes sortes de coutumes sociales et d’habitudes économiques, telles que certaines distributions de richesses, de récompenses ou d’amendes, auxquelles nous demeurons attachés malgré leur caractère injuste et honteux, pour les services qu’elles rendent en encourageant la formation des capitaux. » Étant donné que la volonté exclusive de réussir sa vie sur le plan financier et matériel est le symptôme de pathologies psychiques et d’un manque de maturité, cette forme de réussite n’aurait plus suscité d’admiration et d’envie. Lorsque de plus en plus d’individus découvrent que les valeurs ne sont pas toutes quantifiables, que l’argent ne peut pas tout acheter, et que ce qu’il ne peut pas acheter est l’essentiel (santé, amour, amitié, accomplissement, etc.), le système économique est remis en question dans ses fondements. N’étant plus l’étalon de la valeur de l’individu, non seulement, le pouvoir temporel de l’argent se serait effondré, mais en plus, l’argent serait redevenu ce qu’il aurait toujours dû être : un simple moyen d’échange.
L’effondrement du temps social, du mode de production et de la valeur du travail, ainsi que du pouvoir temporel de l’argent aurait également provoqué le déclin de la légitimité de l’autorité des industriels, des banquiers, des milieux d’affaires et donc, de l’ordre économique. Comme le faisait déjà remarquer George Orwell dans le roman « 1984 » : « Dès le moment de la parution de la première machine, il fut évident, pour tous les gens qui réfléchissaient, que la nécessité du travail de l’homme et, en conséquence, dans une grande mesure, de l’inégalité humaine, avait disparu. Si la machine était délibérément employée dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l’ignorance et la maladie pourraient être éliminées après quelques générations. En effet, alors qu’elle n’était pas employée dans cette intention, la machine, en produisant des richesses qu’il était parfois impossible de distribuer, éleva réellement de beaucoup, par une sorte de processus automatique, le niveau moyen de vie des humains, pendant une période d’environ cinquante ans, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mais il était aussi évident qu’un accroissement général de la richesse menaçait d’amener la destruction, était vraiment, en un sens, la destruction, d’une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d’heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d’une salle de bains et d’un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente, et peut-être la plus importante forme d’inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. […] Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d’êtres humains qui est normalement abrutie par la pauvreté pourrait s’instruire et apprendre à réfléchir par elle-même, elle s’apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n’a aucune raison d’être, et la balaierait. En résumé, une société hiérarchisée n’était possible que sur la base de la pauvreté et de l’ignorance. »[34]
En donnant à chaque individu les moyens de disposer de temps libre, la rivalité, la réussite et la distinction sociale fondées sur le mode « avoir » auraient laissé la place à celles fondées sur le mode « être ». À l’inverse du mode « avoir », le mode « être » est un processus immatériel qui ne peut pas être quantifié et faire l’objet d’accumulation et d’appropriation. En effet, même s’il est possible de quantifier un nombre de films tournés, de buts marqués ou de romans écrits et vendus, le talent d’un réalisateur, d’un joueur de football ou d’un écrivain ne peut pas faire l’objet d’une appropriation ou d’un échange marchand. S’il est possible de s’approprier et d’accumuler de l’argent et des biens matériels, il est en revanche impossible de s’approprier ou d’accumuler un talent, une compétence ou un savoir-faire. Par exemple, un club de football peut acheter un joueur de talent, mais il ne peut pas acheter le talent pour le donner à un autre joueur. Contrairement au rentier qui s’enrichit en dormant, le talent régresse et ne se développe pas s’il n’est pas entretenu par un travail régulier. Ne reposant plus sur la capacité à avoir toujours plus (titre, fonction prestigieuse, statut professionnel, argent, biens matériels, etc.), la légitimité de l’autorité d’un individu aurait reposé sur la volonté, le courage et la détermination de travailler dur pour développer ses connaissances, ses aptitudes et ses talents. Les compétitions sportives, la publication d’articles, d’essais et de romans, les expositions, les pièces de théâtre, les courts métrages, les spectacles vivants, les concerts, ainsi que la participation à la vie politique et associative auraient été autant d’occasions de légitimer son autorité, de faire valoir ses talents et d’exprimer la maîtrise de son art. La rivalité fondée sur le mode « avoir » ayant laissé la place à celle fondée sur le mode « être », l’accumulation financière et matérielle n’aurait plus été un critère de distinction et de réussite sociale.
Étant donné que le statut professionnel, l’accumulation matérielle et la capacité à faire fructifier son argent n’auraient plus été les pôles de référence des individus, de manière consciente ou inconsciente, ils auraient remis en question la légitimité de l’autorité de la hiérarchie sociale issue de l’ordre économique. La légitimité de l’autorité d’un individu n’étant plus déterminée par ce qu’il « a », mais par ce qu’il « est », le pouvoir de l’élite économique se serait effondré au profit d’une nouvelle élite issue des porteurs de la critique artiste. Étant issus du mode « être », les porteurs de la critique artiste auraient donc incarné la nouvelle catégorie sociale dominante. Tandis que l’argent du bourgeois a remplacé la naissance du noble, le mode « être » des tenants de la critique artiste aurait remplacé le mode « avoir » de l’élite économique. L’inversion du rapport à la temporalité aurait donc provoqué un changement de mode de vie, de société, voire de civilisation.
-
Le choix de la crise.
Le travail étant le pilier de l’ordre économique, le gouvernement et le patronat n’ont pas choisi la solution de réduire la durée légale du temps de travail. En effet, comme le fait remarquer Roger Sue, le travail n’est pas un simple moyen de production. « Une telle méprise quant au processus historique de la modernité, à fortiori quand la représentation du travail ne correspond plus à sa réalité, ne peut s’expliquer que si, contre toute évidence, elle est soigneusement entretenue par le discours public. Et, très prosaïquement, parce que ce discours correspond aux intérêts immédiats d’un petit nombre de détenteurs du pouvoir économique ou politique. Maintenir l’illusion d’une civilisation du travail, c’est préserver l’ordre social existant et ceux qui en sont les bénéficiaires, en évitant toute remise en question. Le travail reste en effet l’un des meilleurs modes de maintien de l’ordre social, de contrôle social et de surveillance des individus. D’abord, il occupe « utilement » le temps. Selon le vieil adage, il éloigne du désœuvrement, de l’oisiveté, du vice, mais également d’activités aussi subversives que la réflexion sur les finalités (de la croissance et de la consommation, par exemple), l’engagement citoyen ou tout simplement le développement et l’autonomie personnelle. »[35] Étant donné que l’ordre économique repose sur le temps social, le mode de production et la valeur du travail, l’élite économique n’avait aucun intérêt à choisir la solution de la réduction de la durée légale du temps de travail. Pour que le temps social du travail soit toujours dominant sur la durée de la vie active éveillée, non seulement, le nombre de journées légales de repos hebdomadaire ne doit pas dépasser 2 jours, mais surtout, la norme de la semaine de travail doit être maintenue à 5 jours pour les cadres et les classes moyennes.
Au lieu de choisir la solution de la réduction de la durée légale du temps de travail, l’élite économique a choisi de plonger la société dans un climat de tensions et de crises de plus en plus aiguës. En effet, à la fin des années 60, la crise n’était pas une crise économique, mais une crise du rapport à la temporalité. À partir du choc pétrolier de juin 1973, la crise de la temporalité s’est transformée en crise économique, qui s’est à son tour transformée en crise sociale. En effet, le ralentissement de l’activité économique provoqué par la hausse du prix du baril de pétrole a provoqué une baisse de la croissance du PIB et donc, la hausse du chômage.
Étant donné qu’entre 1949 et 1968, l’écart entre la durée moyenne et la durée légale du temps de travail était compris entre 7 et 5 heures, les trente glorieuses étaient une période de plein emploi. Le chômage étant quasiment inexistant, ceux qui cherchaient un emploi en trouvaient un rapidement. Comme les salariés ne craignaient pas la menace du licenciement, le rapport de force n’était pas en faveur du patronat, mais des salariés. De 1969 à 1975, l’écart entre la durée moyenne et légale étant passé de 5 à 1 jour, le taux de chômage est passé de 2,2 % à 4,4 %. Même si la hausse était seulement de 2,2 points, elle a provoqué un sentiment de peur dans l’esprit des salariés qui n’étaient pas habitués au chômage.
Comme le fait remarquer Roger Sue, le chômage n’est pas un problème pour le patronat, mais pour les salariés. « Quant à son corollaire, le chômage, loin de nuire au système, il le conforte. D’une part, il fait du travail et de l’emploi un bien rare et indispensable qui permet de prétendre encore à leur « centralité » et de nous enfermer dans la contradiction d’une quête nécessaire à chacun et impossible pour tous ; d’autre part, il sert à maintenir une « armée de réserve » qui instille la concurrence entre chômeurs et salariés, entre les salariés eux-mêmes, et qui exerce une pression à la baisse sur les revenus du travail et, et de manière générale, sur l’ensemble des revendications. De ce fait, au cours de la dernière décennie, on compte peu de jours de grève, des augmentations de salaire contenues, un calme apparent qui se paie tout de même de souffrances plus ou moins exprimées et de grandes déflagrations comme en 1995, quand la pression se fait trop forte. Un calme trompeur, tant l’exaspération refoulée que l’on constate régulièrement aux élections, par exemple, risque d’annoncer la tempête et l’explosion sociale. »[36] La hausse du chômage permit d’inverser le rapport de force en faveur du patronat. Désormais, ce n’était plus les patrons, mais les salariés qui avaient peur. La peur du chômage mit fin aux revendications portant sur la hausse des salaires et la réduction du temps de travail au profit de la lutte contre le chômage. Pour enrayer la hausse du chômage, les politiques, les économistes et les industrielles répétaient sans arrêt dans les médias qu’il fallait relancer la croissance du PIB. Étant donné que la création d’emploi était étroitement liée à la relance de l’activité économique et à la compétitivité des entreprises française, les salariés ont accepté la remise en cause progressive des acquis sociaux conquis par le CNR et les luttes sociales des 30 glorieuses.
Le 3 janvier 1972, sous prétexte de répondre au besoin de liberté et d’autonomie des salariés, le gouvernement de Pierre Messmer fit voter une loi sur le travail temporaire qui légalisa le contrat de travail en intérim. Le contrat de travail étant signé avec une agence d’intérim, le salarié n’était plus attaché à une entreprise. L’intérim permet aux entreprises d’ajuster le nombre de salariés et donc, le nombre d’heures de travail en fonction de l’activité de l’entreprise. De 1982 à 2013, en passant de 102 mille à 508 mille personnes, le nombre d’intérimaires a progressé de 398 %[37].
En 1980, le taux de chômage concernait 5,3 %[38] de la population active. Lors de la campagne présidentielle de 1981, François Mitterrand avait l’ambition de lutter contre la hausse du chômage et de « Changer la vie ». Pour créer des emplois et provoquer un changement de mode de vie, son programme de campagne comprenait le passage aux 35 heures. Au lieu de tenir cette promesse, le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy mit en place les 39 heures, la 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Même si ces lois contribuaient à réduire le temps de travail, elles ne menaçaient pas la domination quantitative du temps social du travail sur la durée de vie active.
À partir du milieu des années 80, qui correspond en France au tournant ultralibéral, ce n’était plus les salariés, mais le patronat qui avait repris l’initiative des lois concernant le travail. Sous le prétexte d’améliorer la compétitivité des entreprises et donc, de créer des emplois, les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, ont voté des lois sur l’aménagement du temps de travail. Les lois de 1987, de 1993 et de 1996 ont légalisé le recours au travail à temps partiel, la flexibilité du travail et l’annualisation du temps de travail. De 1980 à 2013, les effectifs à temps partiel sont passés de 8,4 % à 18,4 %[39]. Les salariés étant rarement à l’initiative de ce choix, le travail à temps partiel est souvent subi. L’intérim et le travail à temps partiel sont devenus les variables d’ajustement de l’activité des entreprises. En faisant appel aux intérimaires et aux salariés à temps partiel, l’entreprise pouvait ajuster sa masse salariale et donc, ses heures de travail en fonction du rythme de son activité. En se généralisant, la flexibilité, l’annualisation, les contrats de travail en CDD, l’intérim et le travail à temps partiel ont permis d’augmenter la productivité horaire du travail en ajustant le volume d’heure de travail et les effectifs en fonction de la variation de l’activité des entreprises. En effet, de 1987 à 2013, tandis que le volume d’heures de travail annuel passait de 37,6 à 40 milliards[40] et que les effectifs à temps plein passaient de 21,8 à 25,5 millions[41], la productivité horaire a progressé de 54 %. Les 17,4 % de salarié supplémentaire ont donc dû se partager un nombre d’heures de travail qui avait seulement augmenté de 7,1 %. En permettant d’ajuster la baisse du volume d’heures de travail à la hausse des effectifs sans diminuer la durée légale du temps de travail, toutes ces lois apparaissent donc comme une forme déguisée de réduction du temps de travail au service de l’intérêt des entreprises.
En 1997, étant donné que le taux de chômage était de 10,7 %[42], le gouvernement socialiste de Lionel Jospin a utilisé la réduction de la durée légale du temps de travail pour créer des emplois. En effet, le 13 juin 1998, il a fait voter la loi Aubry sur les 35 heures. Il a donc fallu attendre 18 ans pour que la promesse de campagne de François Mitterrand soit enfin tenue. Il me semble important de préciser qu’à part les 35 heures, toutes les lois sur l’aménagement du temps de travail ont permis de réduire la durée moyenne sans réduire la durée légale du temps de travail. Le 17 janvier 2003, en votant une loi sur la flexibilité du temps de travail, le gouvernement d’Alain Juppé vida les 35 heures de sa substance. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, durant la période de vacances d’août 2008, le gouvernement de François Fillon fit passer le forfait jour des cadres de 218 à 235 jours par an.
Depuis la loi sur les 35 heures, le patronat, des économistes et des sociologues affirment qu’en moyenne, un salarié consacre seulement 9,2 % de sa durée de vie à travailler. Le temps consacré au travail étant très faible, il n’est donc pas nécessaire de le réduire davantage. Face à cette affirmation, il apparaît pertinent de se demander si c’est la réduction de la durée légale du temps de travail ou l’augmentation de l’espérance de vie qui a permis de réduire la durée de vie consacrée au travail. De 1936 à 1998, l’espérance de vie des Français est passée de 58 à 78 ans[43] et la durée légale du temps de travail hebdomadaire est passée de 40 à 35 heures. Étant donné que l’espérance de vie a progressé de 34,5 % et que la durée légale a diminué de 12,5 %, ce n’est donc pas la réduction du temps de travail, mais l’augmentation de l’espérance de vie qui a permis de réduire la durée de vie consacrée au travail. Sur la même période, la part de la durée de vie active éveillée consacrée à l’activité professionnelle est passée de 32,9 % à 26,8 %. Même si cette part a diminué de 6,1 points, en 1998 le temps social du travail était toujours dominant sur la durée de vie active éveillée. En permettant de réduire la durée moyenne du temps de travail, sans réduire la durée légale, toutes les lois sur l’aménagement du temps de travail ont permis d’éviter que le temps social du travail s’effondre au profit du temps libre individuel.
Étant donné que les élites économiques et politiques n’ont pas choisi de réduire la durée légale du temps de travail, la crise de la temporalité s’est progressivement transformée en crise systémique (économique, politique, sociale, écologique, climatique et sanitaire) qui menace notre qualité de vie, notre processus démocratique et la survie des générations présentes et à venir. Curieusement, malgré la crise, de 1973 à 2013, le PIB, le PIB par habitant et la productivité horaire sont respectivement passés de 180 à 2 113 milliards €, de 3 378 € à 32 074 €[44] et de 19,6 € à 46,1 €[45]. La production de richesses n’ayant jamais été aussi élevée, la France ne subit donc pas une crise économique, mais une crise sociale provoquée par la hausse du chômage. S’il n’y avait pas de chômage, la France ne serait pas en crise, mais dans une période de très forte expansion économique. Le taux de chômage ayant atteins 9,8 %[46], la crise sociale s’est progressivement transformée en crise politique. Ces crises ont été amplifiées par la hausse du nombre de précaires et de travailleurs pauvres qui travaillent en intérim et à temps partiel subi.
Les individus en insécurité et en situation de précarité réclament la présence d’un Chef ou d’un État fort pour les protéger. Les partis d’extrême droit instrumentalisent les crises, les guerres, la peur et la hausse du chômage pour conquérir le pouvoir. En 1933, Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la hausse du chômage provoquée par la crise de 1929. L’incapacité des gouvernements de droit et de gauche à enrayer la hausse du chômage et la peur du chômage a provoqué un état de crise politique. En effet, le 24 mai 2014, le Front national était majoritaire aux élections européennes. Lors des élections présidentielles et législatives qui auront lieu en 2017, la candidate du FN sera au second tour et le Front national risquera d’augmenter le nombre de ses débutés.
En s’obstinant à privilégier la relance de la croissance du PIB, l’élite économique a provoqué le réchauffement du climat, le gaspillage des matières premières, la pollution des ressources naturelles et l’extinction de milliers d’espèces. La fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et des pics de pollution de l’air, la dégradation par des nitrates de nappes phréatiques et l’épuisement des terres arables sont les premiers signes d’une catastrophe à venir. Les réserves de pétroles, de gaz naturel et de minerais étant limitées, leur épuisement risque d’amplifier la crise économique politique et sociale actuelle. La compétition que se livreront les États et les multinationales pour s’approprier les stocks restants, risque de conduire à des crises politiques, voire à des guerres. Pour créer des emplois à court terme, le gouvernement français menace donc la qualité de vie et la survie des générations présentes et à venir à moyen et long terme.
Ayant peur de perdre la légitimité de son autorité et ses privilèges, cette « soi-disant » élite, qui se dit progressiste et moderniste, se comporte comme la noblesse à la fin du 18e siècle. Souhaitant préserver la légitimité de son autorité, elle ne veut pas accepter et reconnaître, d’une part, que la valeur du travail, de l’argent et de la consommation sont déclinants, et, d’autre part, que les aspirations d’une part croissantes de la population ont déjà changé. Même si l’ensemble des individus continue à travailler et à consommer par habitude, par conformisme et pour éviter de se retrouver en situation de précarité et d’exclusion, ces valeurs ne font plus sens. En refoulant et en niant cette réalité, l’élite économique entretient un climat de crise qui se cristallise autour d’une croissance molle, d’un taux de chômage endémique, de la montée de l’extrême droite, de risque de guerres, du réchauffement climatique et de l’épuisement de l’écosystème.
Pour en finir avec le chômage, inverser les processus écologiques et climatiques en cours et répondre aux aspirations des Français, il est désormais tant que la réduction de la durée légale du temps de travail soit à nouveau à l’ordre du jour.
Jean-Christophe Giuliani
Cet article est extrait de l’ouvrage « En finir avec le chômage : un choix de société ! ». Ce livre permet d’appréhender les enjeux du choix entre la relance de la croissance du PIB ou de la réduction du temps de travail. Vous pouvez le commander sur le site des Éditions du Net sous un format ePub ou Papier.
Pour accéder aux pages suivantes :
– Le temps libre : un choix de société !
– Les enjeux du temps et de l’emploi du temps
– Disposer de 4 jours de temps libre : un choix de société !
– Combien d’heures devrions-nous travailler pour supprimer le chômage ?
[1] Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 168.
[2] Sue Roger, Temps et ordre social, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, page 29.
[3] Ibid, page 126
[4] Le mode de production correspond à la somme de toutes les actions qui contribuent à produire la société.
[5] Sue Roger, Op Cite, page 137.
[6] Gilles Duteil, Delphine Thomas-Taillandier, Usure, [En ligne] (consulté le samedi 9 avril 2016), https://www.cercle-k2.fr/files/Usure-2015.pdf
[7] Marx Karl, Le Capital, Livre I section V à VIII, Paris, Flammarion, 1985, page 113
[8] Pierre Larrouturou (consulté le 24 janvier 2017), Congrès de Dijon : Changer à gauche, [En ligne] Adresse URL : http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/dijon.html
[9] Pierre Larrouturou (consulté le 24 janvier 2017), Congrès de Dijon : Changer à gauche, [En ligne] Adresse URL : http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/dijon.html
[10] Jacques Vallin & France Meslé, Tables de mortalité françaises pour les xixe et xxe siècles et projections pour le xxie, Paris, Ined, 2001 + CD-rom (Données statistiques, no 4-2001).
[11] Rifikin Jeremy, La fin du travail, Paris, La découverte & Syros, 1996, page 50.
[12] Keynes John Maynard, Essais de persuasion, Paris, Gallimard, 1933, page 176.
[13] Russel Bertrand, (page consultée le 31 janvier 2014), Éloge de l’oisiveté, [en ligne]. Adresse URL : http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/20/eloge-de-l-oisivete3/preview/page/16/
[14] Pierre Larrouturou (consulté le 24 janvier 2017), Congrès de Dijon : Changer à gauche, [En ligne] Adresse URL : http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/dijon.html
[15] Jacques Vallin & France Meslé, Tables de mortalité françaises pour les xixe et xxe siècles et projections pour le xxie, Paris, Ined, 2001 + CD-rom (Données statistiques, no 4-2001).
[16] La Croix Rize Annie, Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930, Paris, Armand Colin, 2006.
[17] Insee, Évolution de l’espérance de vie à divers âges, statistiques de l’état civil et estimations de population, France métropolitaine, fin 2014
[18] Insee, (6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés/ 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche), Comptes nationaux, Base 2010.
[19] Insee, 6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés, Comptes nationaux, Base 2010.
[20] Insee, Partage de la valeur ajoutée à prix courants en 2013, Comptes nationaux, Base 2010.
[21] Insee, Insee, Partage de la valeur ajoutée à prix courants en 2013, Comptes nationaux, Base 2010.
[22] Insee, 1.101 Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants, Comptes nationaux, Base 2010,
[23] Insee, Évolution de l’espérance de vie à divers âges, statistiques de l’état civil et estimations de population, France métropolitaine, fin 2014
[24] Le livre blanc de la retraite, Évolution de l’âge « légal » de l’ouverture des droits à la retraite.
[25] Lefebvre des Noettes V. Epidémiologie psychiatrique. Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie (NPG), 2002; janvier février (7) : 10-15.
[25] Rousselet Jean, L’allergie au travail, Paris, Ed du Seuil, 1974, page 35
[26] Ibid, page 57.
[27] Kazan Elia, L’arrangement, Paris, éditions Stock, 1969
[28] Boltanski Luc et Chiapello Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, page 245.
[29] Pierre Larrouturou (consulté le 24 janvier 2017), Congrès de Dijon : Changer à gauche, [En ligne] Adresse URL : http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/dijon.html
[30] Insee, (6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés / 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche), Comptes nationaux, Base 2010.
[31] Keynes John Maynard, Essais de persuasion : Partie V, chapitre II, Perspective économique pour nos petits enfants, Paris, Gallimard, 1933., page 170 – 178.
[32] Insee, T306, chômage et taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) selon l’ancienne définition, par sexe et âge regroupé, en fin de trimestre, données cvs, Série archive, estimation mensuelle du chômage BIT.
[33] Gorz André, Métamorphoses du travail : critique de la raison économique, Paris, Galilée, 1988, page 151
[34] Orwell George, 1984, Paris, Gallimard, 1950, page 269.
[35] Sue Roger, La société contre elle-même, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005, page 89
[36] Sue Roger, La société contre elle-même, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005, page 90
[37] Insee, T402: Formes particulières d’emploi et parts dans l’emploi, par sexe et âge regroupé, en moyenne annuelle, données de 1982 à 2013, corrigées pour les ruptures de série, en France métropolitaine, personnes de 15 ans et plus, enquêtes Emploi (calculs Insee).
[38] Insee, Taux de chômage depuis 1975, enquêtes Emploi 1975-2011, séries longues.
[39] Insee, enquêtes Emploi 2003-2011, Temps partiel selon le sexe et la durée du temps partiel en 2012.
[40] Insee, 6.213 Volume total d’heures travaillées par branche / 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Comptes nationaux, Base 2010
[41] Insee, 6.209 Emploi intérieur total par branche en nombre d’équivalents temps plein, Comptes nationaux, Base 2010
[42] Insee, T403: Emploi et part dans l’emploi selon la quotité de temps de travail, par sexe et âge regroupé, en moyenne annuelle, données de 1975 à 2013, corrigées pour les ruptures de série, en France métropolitaine, personnes de 15 ans et plus, enquêtes Emploi (calculs Insee).
[43] Jacques Vallin & France Meslé, Tables de mortalité françaises pour les xixe et xxe siècles et projections pour le xxie, Paris, Ined, – 2001 + CD-rom (Données statistiques, no 4-2001).
[44] Insee, 1.115 Produit intérieur brut et revenu national brut par habitant, Comptes nationaux, Base 2010
[45] Insee, 6.208 Emploi intérieur total par branche en nombre de personnes, 6.202 Valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés, Comptes nationaux, Base 2010
[46] Insee, Population au chômage (en milliers) et Taux de chômage (en %), enquêtes Emploi 1975-2013, séries longues.
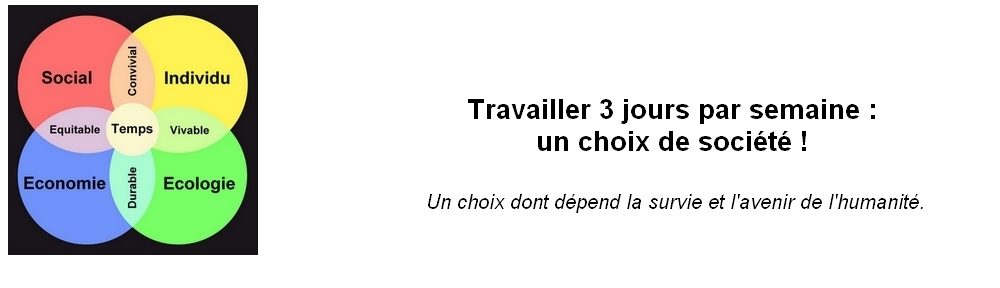

Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Le texte du blog est trop long et je ne dispose pas des capacités nécessaires pour le résumer.